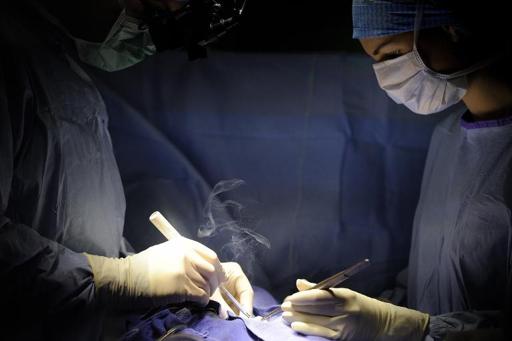-I. PRELIMINAIRES
Comme un fleuve irrigué par de nombreux affluents, voilà plus de neuf ans que l’on entend des voix s’élever pour ou contre le « découpage territorial », rappelant l’époque de la tour de Babel avec son cortège de divisions et d’incompréhensions. Cette cacophonie s’est intensifiée depuis la récente promulgation de la loi de programmation n° 15/004 du 28 février 2015 déterminant les modalités d’installation de nouvelle s provinces.
En effet, à la faveur de la révision constitutionnelle sanctionnée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011, l’article 226 de la Constitution fut modifié dans le sens de la suppression du délai constitutionnel initial, laissant au législateur le soin d’adopter une loi de programmation déterminant les modalités d’installation de ces nouvelles provinces.
Ladite loi de programmation – tant attendu – a pour objet la mise en application de la volonté du peuple congolais. Elle fixe un nouveau calendrier d’installation des provinces qui est conçu en deux phases : la première concerne la Ville de Kinshasa et les quatre provinces actuelles non démembrées ; la seconde, dont la durée ne peut excéder cent vingt jours à dater de la mise en place des commissions, concerne les autres provinces dont le Haut- Lomami, le Haut- Katanga, le Lualaba et le Tanganyika issues de la province du Katanga.
Cette loi définit également les actions à entreprendre en vue de la mise en place effective de ces provinces, parmi lesquelles la désignation des membres de la commission, par le décret du Premier Ministre, chargés d’effectuer des tâches spécifiques notamment, d’établissement de l’actif et du passif des anciennes provinces.
En optant pour la « décentralisation », la République Démocratique du Congo (RDC) n’innove pas. Plusieurs pays africains l’ont opté à la suite des crises économiques, sociales et/ou politiques qu’ils ont connu. La décentralisation est souvent perçue comme la panacée pour relever toute une série de défis en matière de développement: reconstruire l’État, combattre la corruption, restaurer la confiance dans le gouvernement, promouvoir des formes de gouvernance plus participatives et lutter contre la pauvreté. En pratique, les choses sont loin d’être aussi simples si, pour d’aucuns, la décentralisation est intrinsèquement une bonne chose à laquelle il convient d’avoir recours en toutes circonstances, il existe cependant un courant de scepticisme important et la RDC ne fait pas exception.
C’est pourquoi il sied de réfléchir sur les conditions de sa réussite !
II. AU DELA DES PESANTEURS ET SCEPTICISME AFFICHES
Depuis que la décentralisation fut introduite dans la Constitution, sa matérialisation en RDC n’a cessée de rencontrer des pesanteurs qui font que l’urgence de l’application de cette politique fut diversement appréciée. Pour nous en convaincre, nous faisons recours à la situation de la province du Katanga. En effet, au terme de l’article 2 de la Constitution, la RDC compte 25 provinces et la ville de Kinshasa, contre 10 provinces et la capitale actuellement. En clair, il sera procédé au découpage territorial. À ce sujet, le Katanga qui éclate en quatre provinces : le Haut- Lomami, le Haut- Katanga, le Lualaba et le Tanganika. Mais l’on a assisté au chapelet des pétitions et des contre-pétitions sur le découpage ou non du Katanga, lettres ouvertes et prises de position confuses. Tous les coups furent permis. Certains opérateurs politiques soutenant mordicus le processus compte tenu de leur attachement à de sentiments tribaux et/ou ethniques. Par contre ceux qui sont en défaveur de la décision craignent de perdre certains avantages.
Au-delà de toutes ces positions, contre-positions, peurs et cauchemars sur le découpage territorial au Katanga, il est impérieux que les antagonistes aient présent à l’esprit que la RDC est un « Etat uni et Indivisible» et la décentralisation, d’essence constitutionnelle soit-elle, n’est pas synonyme de fédéralisme, encore moins de confédéralisme. La ligne de démarcation mérite d’être rapidement tracée…
Ainsi, nous soutenons qu’il ne s’agit plus de décider si le découpage territorial est une option, ou de ne pas la voir franchir l’étape du stade initial, mais plutôt de savoir comment le mettre en œuvre dans la pratique pour qu’il puisse réaliser les objectifs qu’il s’est fixés en assurant à la fois la stabilité, l’efficacité de l’Etat ainsi que les libertés démocratiques créatrices d’idées et de progrès. Ainsi, la RDC a pris un tournant décisif dans le mode de gouvernance de ses provinces puisque les principes de l’Etat central fortement décentralisé ont été précisés comme fil conducteur pour le fonctionnement des institutions.
L’on doit effacer les peurs d’être chassés dans telle ou telle autre contrée ou d’aller obligatoirement résider ou travailler uniquement dans sa province dite d’origine car, tout congolais a le droit de s’établir partout ou il veut et personne ne pourra le lui en priver sans violer la Constitution et les droits fondamentaux. Pour ce faire, ayons tout simplement à l’esprit l’idée que la décentralisation est juridiquement un mode d’organisation des pouvoirs publics. C’est le transfert de certaines compétences de l’Etat à des collectivités territoriales, autonomes financièrement et juridiquement du pouvoir central. Mais en réalité, elle est aussi l’affaire de chaque citoyen car elle modifie profondément ses relations avec les pouvoirs publics. TOCQUEVILLE affirmait par exemple que la centralisation administrative n’était propre « qu’à énerver les peuples » car elle tendait « à diminuer parmi eux l’esprit de cité ».
En RDC, les mutations institutionnelles et socio-politiques attendues doivent être comprises comme un élargissement de la démocratie participative pour stimuler la responsabilisation des acteurs à la base. Dans ce sens, la décentralisation offre non seulement des espoirs d’un renforcement de la démocratie et de la bonne gouvernance locale mais aussi des promesses d’une plus grande efficacité et efficience dans l’offre de services adaptés aux besoins locaux et un cadre adapté pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Toutefois, la décentralisation n’apportera une plus grande efficience dans l’offre des services, une meilleure gouvernance locale et ne contribuera à la réduction de la pauvreté et à la consolidation de la paix sociale seulement si certaines conditions sont remplies.
III. QUELQUES CONDITIONS POUR UN DECOUPAGE TERRITORIAL REUSSI AU KATANGA ET EN RDC
3.1. Le respect et la compréhension des textes légaux qui organisent le découpage territorial par le peuple et ses élus
La culture démocratique veut qu’après la promulgation de la loi de programmation qui détermine, en application de l’article 226 de la Constitution les modalités d’installation de nouvelles Provinces en RDC et pour le cas d’espèces, qui détermine les quatre provinces qui sont issues de la province du Katanga telles que énumérées à l’article 2 de la Constitution, les frondeurs doivent s’incliner et se mettre au pas. Il leur aussi appartient le droit de mener d’autres démarches légales pour que leurs desideratas soient entendus pour un remembrement ou pour un autre démembrement possible. Cela doit cependant se faire dans le strict respect des normes.
L’on entend donc par modalités d’installation de nouvelles Provinces, l’ensemble des opérations à effectuer dans chaque Province selon le calendrier d’installation des nouvelles provinces .
A ce sujet, l’on doit retenir que l’installation de nouvelles Provinces et de la Ville de Kinshasa se déroule en deux phases dont la première phase concerne les Provinces du Kongo Central, du Maniema, du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et la Ville de Kinshasa. La deuxième phase concerne les Provinces du Bas-Uelé, de l’Equateur, du Haut-Katanga, du Haut-Lomami, du Haut-Uélé, de l’Ituri, du Kasaï, du Kasaï Central, du Kasaï Oriental, du Kwango, du Kwilu, du Lomami, du Lualaba, de Maï-Ndombe, de la Mongala, du Nord-Ubangi, du Sankuru, du Sud-Ubangi, du Tanganyika, de la Tshopo et de la Tshuapa. [ Article 3]
L’installation des nouvelles provinces issues du Katanga se fait dans les quinze jours suivant la promulgation loi et pour les besoins de leurs installations, sur proposition du Ministre ayant l’intérieur dans ses attributions, un Décret délibéré en Conseil des Ministres met en place une Commission par Province à démembrer, ici le Katanga qui comprendra aussi des sous-commissions en vue d’effectuer les opérations relatives à l’installation.
Composée d’au plus quinze membres à raison de trois membres par sous-commission, la Commission a pour tâches de :
– établir l’état des lieux de la Province ;
– dresser l’actif et le passif de la Province ;
– repartir, entre les nouvelles Provinces, le patrimoine ainsi que les ressources humaines et financières.
Il sied donc d’insister sur le respect par l’exécutif national de mettre en place cette commission et que le travail débute sans oublier l’audit afin de contrer les dissipations et autres manipulations financières et dissimulations des deniers par les dirigeants sortant !
3.2. L’avenir du découpage territorial quand les députés provinciaux demeurent encore acteurs voire actifs
Dans les trente jours de sa constitution, la Commission présente son rapport des travaux à l’Assemblée provinciale existante qui en prend acte.
La présentation du rapport par la Commission et sa prise d’acte par l’Assemblée provinciale existante enclenchent le processus d’éclatement de la Province.
Il sied de nous poser la question de la légitimité et du sérieux des députes provinciaux qui doivent prendre acte du rapport de la commission afin d’enclencher le processus si l’on sait que la plupart desdits députés sont des godillots comme bien élaboré dans notre livre intitulé « Le parlement provincial pour quoi faire ? » . N’est-ce pas laisser cette charge entre les mains de ceux qui ne partagent pas voire ne portent pas la voix du peuple depuis leurs élections par hasard en 2006 ? Pour le cas du Katanga, comment cette institution – Assemblée provinciale – peut-elle enfin se prendre au sérieux et ne pas demeurer sous le dictat de son « speaker » ennemi du découpage territorial quand ses intérêts sont menacés oubliant que le fédéralisme tant prôné n’est pas loin de ce qui se trouve sur le gâteau ?
Au regard de la loi de programmation, le quinzième jour suivant la présentation du rapport par la Commission et sa prise d’acte par l’Assemblée provinciale existante, chaque Assemblée provinciale de la nouvelle Province se réunit de plein droit en session extraordinaire en vue de :
1. l’installation du Bureau provisoire dirigé par le doyen d’âge assisté de deux membres les moins âgés ;
2. la validation des pouvoirs qui vaut pour le reste du mandat à courir.;
3. l’élaboration et l’adoption du Règlement intérieur ;
4. l’élection et l’installation du Bureau définitif ;
5. l’élection du Gouverneur et du Vice-gouverneur de Province, conformément à l’article 168 de la Loi électorale.
La séance d’ouverture est présidée par le fonctionnaire ayant le grade le plus élevé dans l’administration publique de la nouvelle Province.
La session extraordinaire prend fin à l’épuisement de l’ordre du jour.
Lorsqu’une Assemblée provinciale ne se réunit pas dans le délai sans motif valable, le Ministre ayant l’intérieur dans ses attributions la convoque en session extraordinaire. Dans ce cas, la séance d’ouverture est présidée par un délégué du Ministre de l’Intérieur.
La durée de l’installation effective des institutions provinciales ne peut excéder cent vingt jours à dater de la mise en place des Commissions. Voilà donc qu’il est urgent que la commission soit nommée et mise en place et que le travail se fasse sans délai pour que les députés provinciaux ne se refugient derrière le défaut de commission alors qu’ils doivent cette fois-ci sortir de leurs carcans et devenir des tambourineurs justifiant leur existence par les deux attributions fondamentales qui fondent la compétence de tout parlement : adopter la loi des hommes, et contrôler l’Administration chargée de l’appliquer. Cette double justification répond à la théorie de la séparation des pouvoirs de MONTESQUIEU. Pourtant, le Parlement provincial du Katanga a fait montre de l’amateurisme ou carrément ce qu’il convient d’appeler « l’analphabétisme parlementaire », « l’incultisme démocratique », etc.
Il est certes vrai qu’avec les élections passées, nous avions dans une certaine mesure salué la victoire de la démocratie. Mais, une question demeure : Avons-nous choisi des bons acteurs ? La réponse est bien connue de tous. De plus en plus, nous déplorons amèrement la crise de légitimité que les Parlements provinciaux, institutions pivots de la démocratie – traversent. Au Katanga, le gouvernement provincial dominant l’agenda; la cohabitation entre les deux institutions politiques provinciales basée sur les intérêts égoïstes et mesquins ont engendré une gouvernance provinciale peu transparente démocratiquement, et les citoyens se demandant a quand le bout du tunnel ? Serait-ce par l’installation des nouvelles provinces ?
De ce qui précède, l’on est en droit de se demander dans quelles mesures, l’Assemblée provinciale qui doit être le symbole de l’expression démocratique joue-t-elle encore un rôle dans le processus de décision politique de nos démocraties dans les nouvelles provinces? Ainsi, avec le lancement du processus d’installation des nouvelles provinces, il sied que les députés réfléchissent sur leur rôle. Il est temps que le Parlement provincial cherche d’apparaître de plus en plus comme une institution à même de répondre aux attentes démocratiques profondes. Sans être le lieu unique des décisions importantes, le Parlement en est bien souvent la condition nécessaire. Il ne doit plus être « la chambre d’enregistrement » ou mieux « la caisse de résonance » que l’on dénonce, mais un acteur incontournable dans un système global de production de la norme : lieu de négociation de la décision finale, tribune d’affrontement des idées, meilleur moyen d’assurer un débat transparent et équilibré. Par ailleurs, le Parlement devra être de plus en plus, notamment dans sa fonction de contrôle, comme un acteur à même de répondre à l’exigence croissante de compte-rendu, constituant ainsi des garanties démocratiques : les Gouvernements provinciaux des nouvelles provinces issues du Katanga devront agir désormais sous le contrôle effectif des parlementaires.
3.3. L’implication active des citoyens dans le processus
Presque tous les débats voire « ébats et émois » sur le découpage en RDC sont faits en l’absence du peuple, le souverain et bénéficiaire primaire. Il est donc important que les citoyens soient au centre du processus par implication active dans le processus. En effet, pour que réussisse la décentralisation, le processus doit être inspiré par l’exigence de la population d’une redéfinition des rapports entre l’État et ses citoyens et non être l’œuvre des calculs politiciens. La population locale doit s’approprier la réforme pour veiller à ce que l’esprit de la décentralisation soit respecté, que les dispositions juridiques formelles reflètent ses préoccupations et les réalités dans lesquelles elle vit et que ces dernières soient appliquées. Pour y parvenir de façon efficace, la population doit acquérir un certain nombre de compétences et d’aptitudes, en particulier une bonne compréhension des textes relatifs à la décentralisation. Les citoyens doivent avoir une meilleure compréhension des enjeux et de la manière dont ils peuvent participer et intervenir efficacement au niveau local dans les processus de prise de décisions qui affectent leur vie et leurs moyens d’existence. Fondamentalement, la population locale doit avoir foi dans les réformes et les opportunités qu’elles offrent, être convaincue qu’elle est capable de jouer un rôle important et demander aux collectivités de lui rendre compte de la gestion des affaires locales.
Reconnaissons cependant que la réalisation de cette condition est un défi majeur en RDC car le chapelet de la pauvreté et l’analphabétisme, freine la participation active et informée des populations locales. Là où l’information existe, elle apparaît souvent tintée des discours partisanes et de division pour faire échec à la décentralisation.
3.4. Rendre des entités décentralisées et leurs animateurs capables et compétitifs
Fort de l’arsenal juridique sur la décentralisation, les collectivités locales doivent assurer des services sociaux et économiques (santé, alimentation en eau, éducation, etc.) sur la base de plans de développement locaux. Elles sont censées s’acquitter de ces services dans la concertation et l’équité, en veillant à la pleine participation des communautés qui relèvent de leur autorité. L’une des raisons principales de la décentralisation est d’accroître l’efficience et l’efficacité générales en permettant aux collectivités locales de renforcer leur sensibilité, leur responsabilité à l’égard des citoyens et l’efficacité de la production et de la fourniture de services. Ainsi, le processus de décentralisation est essentiel pour que les instances locales puissent jouer un rôle actif et important en termes de gouvernance locale.
À court terme, le succès de la décentralisation dépend largement de la mesure dans laquelle la population locale constate qu’elle apporte des avantages tangibles. Étant donnés les niveaux de pauvreté actuels, cette population, qui perçoit les principes de la gouvernance démocratique comme essentiels à l’expression de ses initiatives, veut aussi voir mises en œuvre des mesures concrètes susceptibles de résoudre ses problèmes quotidiens : Installations sanitaires et éducatives inadaptées, alimentation en eau insuffisante, manque d’opportunités en matière d’emploi, de débouchés commerciaux et d’investissement, routes impraticables voire inexistantes, etc. Si les collectivités locales ne peuvent répondre à ces questions, cela compromettra gravement leur légitimité et la possibilité d’opérer des changements structurels dans le mode de gestion des affaires locales.
Il sera aussi essentiel de renforcer les capacités des autorités locales pour répondre aux défis de la « décentralisation- découpage » et leur permettre d’agir en adoptant une démarche participative, transparente et durable pour réussir à gagner la confiance et la reconnaissance de la population locale, et, à terme, développer et renforcer leur autonomie financière. Reconnaissons cependant, que cela ne sera pas que facile.
3.5. Fournir un cadre institutionnel favorable qui donne l’autorité et les pouvoirs de décision au niveau local.
Les textes légaux sur la décentralisation permettent la création des entités territoriales légalement reconnues, dotées d’un budget et d’un personnel propre, ainsi que des pouvoirs de décision sur un éventail de domaines relevant directement de leur compétence. Le principe de subsidiarité et la nécessité de faire en sorte que le transfert de responsabilités s’accompagne d’un transfert simultané de ressources sont reconnus. Toutefois, dans la pratique, cet engagement politique en faveur d’un transfert de compétences connaît des embûches en RDC qu’il faille élaguer au plus tôt. De surcroît, l’absence d’un pouvoir effectif des collectivités locales sur le contrôle de leurs ressources financières compromettra leur viabilité économique et nuira à la légitimité du processus de décentralisation aux yeux de la population locale. Il appert donc nécessaire que tous les boulons d’étranglement du processus de décentralisation soient réellement supprimés afin que renaisse la RDC de ses cendres comme le phénix. Ce n’est donc pas un problème de moyens mais de volonté et vision managériale. Quelles garanties avons-nous qu’en réduisant les provinces de onze a une, la RDC serait nantie en infrastructures et que la misère cesserait ? Aucune et l’on fausserait les prémisses !
IV. En guise de conclusion !
Que conclure, sauf affirmer qu’au delà des inquiétudes politiciennes plutôt que citoyennes, il ne nous reste qu’à affirmer que découpage territorial du Katanga – en quatre nouvelles provinces – réussi constituera une réforme politique mettant les élus locaux au défi de répondre aux demandes des populations.
Il permettra de mettre en relation directe le besoin social tel qu’il est vécu par le citoyen et la décision politique qui lui répond. Il autorisera alors non seulement une réforme de l’Etat par la déconcentration de ses moyens et la réduction de son périmètre d’intervention. Un véritable processus de reconstruction de l’Etat pourrait ainsi être amorcé en s’appuyant sur les communautés de base et les entités décentralisées. Cela est d’autant vrai car, l’espace local constitue, en effet, le lieu d’ancrage de la citoyenneté, le maillon initial des liens sociaux et la base du « vouloir vivre collectif ». Pour cette raison, il est impérieux de favoriser l’émergence d’entités fortes au plus près des préoccupations des citoyens. Mais une gouvernance locale ne peut être efficace que si les relations avec les autres niveaux de pouvoir sont prises en compte, donnant lieu à des échanges, à des négociations et à des actions de coopération. Comme qui dirait l’unité dans la diversité et non dans l’adversité !
D’ou l’importance des actions à entreprendre pour un découpage territorial réussi et la loi sous examen est explicite quand elle affirme à son article 10 : « …dès l’installation de nouvelles Provinces, le Gouvernement de la République initie, en concertation avec les autorités provinciales, un programme d’équipement, de réhabilitation et de construction des infrastructures nécessaires au fonctionnement de nouvelles provinces. Il prévoit, sur une période de cinq ans, un budget pluriannuel d’investissement destiné au financement des travaux prioritaires de nouvelles Provinces. Il procède annuellement à une évaluation des travaux réalisés dans le cadre du programme …. Le rapport d’évaluation de ces travaux est présenté, à chaque session budgétaire, à l’Assemblée Nationale et au Sénat… ».
Toutefois, pour prévenir les risques d’iniquité territoriale, de dilution des responsabilités et des compétences, l’instauration d’une démocratie locale doit être assortie de politiques complémentaires (renforcement des capacités, déconcentration des services de l’Etat, aménagement du territoire…) auxquelles tous les Congolais devront contribuer.
Au finish, retenons qu’ « il n’y a rien de plus puissant qu’une idée dont le temps est venu ». Cette observation de Victor Hugo semble pouvoir avec modestie être appliquée à cette contribution pour une découpage territorial réussi au Katanga et partant en RDC.
 -Le monde salue le geste républicain du président Goodluck Jonathan qui a reconnu mardi sa défaite face au candidat de l’opposition l’ex-général Muhammadu Buhari. Avant lui, d’autres dirigeants africains se sont retirés après avoir été battus aux élections.
-Le monde salue le geste républicain du président Goodluck Jonathan qui a reconnu mardi sa défaite face au candidat de l’opposition l’ex-général Muhammadu Buhari. Avant lui, d’autres dirigeants africains se sont retirés après avoir été battus aux élections.