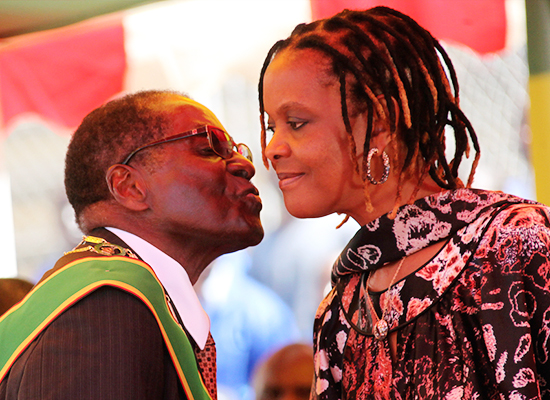-A la fin des années 1990, le Zimbabwe était le grenier à céréales du continent. Le pays comptait aussi parmi les premiers exportateurs de tabac au monde. Mais la confiscation des terres détenues par les agriculteurs blancs, lancée dans la violence il y a quinze ans, a mis le pays à genoux. Ces fermiers étaient 4 000 à la fin du siècle dernier, ils ne sont plus que 150 aujourd’hui. Leurs hectares ont été donnés le plus souvent à des soutiens du président Robert Mugabe. La plupart des bénéficiaires noirs ont laissé ces terres arables à l’abandon, soit par désintérêt, soit parce qu’ils n’avaient pas été choisis parmi les agriculteurs ayant le savoir-faire requis ou n’avaient pas les fonds et les moyens pour les exploiter. Aujourd’hui, avec la caution et même les encouragements du gouvernement de Mugabe, les Noirs sont de plus en plus nombreux à solliciter l’aide des Blanc qui acceptent volontiers de retourner à la terre. C’est le premier volet de notre série de reportages sur le Zimbabwe.
-A la fin des années 1990, le Zimbabwe était le grenier à céréales du continent. Le pays comptait aussi parmi les premiers exportateurs de tabac au monde. Mais la confiscation des terres détenues par les agriculteurs blancs, lancée dans la violence il y a quinze ans, a mis le pays à genoux. Ces fermiers étaient 4 000 à la fin du siècle dernier, ils ne sont plus que 150 aujourd’hui. Leurs hectares ont été donnés le plus souvent à des soutiens du président Robert Mugabe. La plupart des bénéficiaires noirs ont laissé ces terres arables à l’abandon, soit par désintérêt, soit parce qu’ils n’avaient pas été choisis parmi les agriculteurs ayant le savoir-faire requis ou n’avaient pas les fonds et les moyens pour les exploiter. Aujourd’hui, avec la caution et même les encouragements du gouvernement de Mugabe, les Noirs sont de plus en plus nombreux à solliciter l’aide des Blanc qui acceptent volontiers de retourner à la terre. C’est le premier volet de notre série de reportages sur le Zimbabwe.
De notre envoyé spécial à Beatrice, Nicolas Champeaux
Les herbes sont hautes, les buissons touffus et les vieilles clôtures sont à terre. La nature a repris le dessus sur cette parcelle en périphérie de Beatrice, au Zimbabwe. Elle a été confisquée à un fermier blanc en 2003 et donnée à deux vétérans de la lutte pour la libération. « C’est la portion qui est exploitée par mes deux partenaires », explique au volant de son 4×4 Claude Dreyer, un agriculteur blanc âgé de 58 ans.
Le partenariat commercial que Claude a noué ne porte que sur une partie des terres allouées à ses deux associés : « Pour rendre service, j’ai tout de même planté sur leur portion ce maïs qui arrive à peine aux genoux. Ce n’est pas irrigué, mais ça permet de nourrir un peu la communauté. » Ses deux partenaires noirs n’étaient pas parvenus à exploiter la terre parce qu’ils n’avaient pas les moyens de lever des fonds. Les invasions des fermes tenues par les agriculteurs commerciaux d’origine européenne ont été lancées au début des années 2000 dans la plus grande improvisation. Les deux associés ont donc cherché à s’associer avec un fermier blanc. D’après les termes du contrat de trois ans renouvelables, signé en avril 2015, Claude a l’usufruit d’une parcelle de 20 hectares. Selon le document, validé par le gouvernement, il peut les cultiver comme il l’entend, ses partenaires n’ont aucun droit de regard. En échange, il doit verser à ses deux associés une allocation mensuelle, indexée sur les profits. Claude s’est aussi engagé à aider ses partenaires, qui ont refusé de nous parler, à mieux exploiter les hectares qu’ils ont conservés.
« Je m’engage dans une terre inconnue »
En tout, Claude a investi un quart de million de dollars sur ses 20 hectares. « Vous allez voir, on arrive à mon projet, et là c’est autre chose, en plus vous avez de la chance, mes gens sont encore au travail », explique fièrement Claude, toujours au volant, à l’embouchure d’une piste cabossée.
Alors que le soleil se couche, une quinzaine d’ouvriers agricoles, payés quatre dollars US la journée, vident des sacs de maïs à l’arrière d’un camion. Un contremaître remplit un tableau au stylo dans son cahier. Derrière le groupe se dressent, sur plusieurs hectares, des tiges de maïs aussi grandes qu’un basketteur du championnat américain NBA. « Ce champ fait partie de ma portion de la joint-venture (société commune NDLR). J’ai dû retaper tout le système d’irrigation sous-terrain », explique Claude avant de nous emmener sur une berge de la rivière Mupfure. Il nous montre, non sans fierté, les deux pompes qu’il a installées. L’une fonctionne à l’électricité, mais en raison des nombreuses coupures de courant, une autre tourne au diesel.
Outre l’irrigation, Claude a aussi dépensé beaucoup d’argent pour débroussailler, acheter des équipements, des semences, et il emploie quarante saisonniers. Divorcé, remarié et père de quatre enfants, il a vendu sa maison pour financer cette aventure. « Je m’engage dans une terre inconnue, reconnaît Claude, le visage creusé de rides. J’ai vendu ma maison. Je n’aurais pas pu monter cette opération sans capital de départ. Les banques ne m’auraient jamais prêté d’argent, car la terre n’est pas à moi et parce que le contrat ne dure que trois ans renouvelables. J’espère dégager des profits d’ici deux ans. Mais je suis prêt à prendre ce risque, car je pense que c’est la marche à suivre pour le Zimbabwe. »
Claude avait préalablement consulté le fermier blanc qui était propriétaire de ces terres et qui a été expulsé. « D’un point de vue éthique, je tenais à le voir, et il m’a donné son feu vert. Il m’a même aidé, il m’a indiqué où étaient enterrés certains canaux d’irrigation », se souvient notre hôte, cigarette au bec et sourire aux lèvres.

Claude a rénové tout le système d’irrigation. Sur une berge de la rivière Mupfure, il a également installé deux pompes à eau.
Nicolas Champeaux/RFI
Au retour de notre promenade, nous rencontrons Stoff Hawgood. Sa ferme jouxte les terres des deux associés de Claude. C’est lui qui l’avait introduit auprès d’eux. Stoff est heureux d’avoir joué le rôle d’entremetteur: « Je crois que les autorités commencent à comprendre qu’il y a au Zimbabwe des gens qui ont accès à la terre, mais qui sont sans ressource, et d’autre part des gens qui ont des ressources, mais qui n’ont pas accès à la terre. Le gouvernement essaie donc de faire en sorte que cette terre soit de nouveau rentable en autorisant les détenteurs de capitaux à accéder légalement à la terre pour relancer la production. »
Un aveu d’échec du gouvernement Mugabe
Le recours aux fermiers blancs, par le biais de ces joint-ventures, est un aveu d’échec de la part de la ZANU-PF au pouvoir, parti anti-impérialiste issu de la lutte pour l’indépendance. Le cas de Stoff Hawgood est, en soi, éclairant. Il emploie aujourd’hui quatre cents personnes, contre mille il y a une quinzaine d’années. En 2004, les autorités ont nationalisé les terres, et il a perdu le titre de propriété du demi-millier d’hectares acquis par ses parents en 1955, mais il n’a jamais été expulsé.
En 2010, les autorités l’ont approché pour qu’il se mette en règle et postule pour pouvoir être l’occupant légal de la terre de ses parents. « Je fais pousser du soja, j’ai 200 hectares de maïs, 140 hectares de pommes de terres, ils donnent quarante tonnes de patates par hectare, et je produis dix mille litres de lait par jour. Les autorités ont dû voir que j’étais très productif et j’aide l’hôpital de campagne et les écoles, j’ai été sur cette ferme toute ma vie, j’ai beaucoup travaillé avec la communauté et je suis toujours resté à l’écart de la politique », explique Stoff avec conviction. Aujourd’hui, il continue d’investir avec parcimonie, mais il n’est pas prêt à prendre les mêmes risques que son ami Claude : « L’Etat a nationalisé les terres, nous ne pouvons plus convaincre nos banques de nous prêter de l’argent en leur disant que nous pouvons vendre en cas de coup dur. Et les agriculteurs ne veulent pas investir leurs deniers personnels ».
Claude lui est prêt à ce sacrifice. « Je suis heureux de travailler avec ceux qui se sont vu octroyer des terres, c’est une expérience rafraîchissante. Selon moi, depuis le début, ces terres devaient revenir aux populations indigènes. On aurait pu éviter les violences auxquelles on a assisté. Entre l’indépendance en 1980 et les années 2000, les Blancs auraient dû prendre les devants, être plus coopératifs et proposer un accord avec le gouvernement. Les Blancs n’ont pas eu la bonne attitude », soupire Claude.
Son ami Stoff n’est pas tout à fait d’accord : « Les Blancs ont commis l’erreur de se mêler de politique. Mais il est injuste de dire qu’ils n’ont rien fait pour corriger les inégalités héritées du passé. Je pense que tout le monde est fautif, on ne peut pas tout mettre sur le dos des Blancs, même s’ils auraient pu faire plus. De toute façon la réforme agraire est un processus. Les difficultés économiques du pays font qu’aujourd’hui tout le monde est prêt à se retrouver autour de la table et à identifier la marche à suivre. »
Les autorités semblent sur la même longueur d’onde et assument pleinement ces partenariats entre les vétérans de la guerre de libération et les fermiers noirs. Ils résultent d’une décision du Conseil des ministres. Le gouvernement encourage même les fermiers blancs qui ont quitté le Zimbabwe à revenir au pays et à investir. C’est indéniablement un revirement.
« Le Zimbabwe a besoin de l’expertise et des capitaux des fermiers blancs qui ont rejoint la diaspora et nous disons à tous ceux qui ont fui et qui sont attachés sentimentalement au Zimbabwe qu’ils peuvent revenir », a indiqué à RFI Christopher Mutsvangwa, ministre en charge des Vétérans. Joint au téléphone, il s’est aussi livré à une sorte de mea culpa : « La terre au Zimbabwe doit de nouveau être envisagée sous l’angle de la productivité. Cette terre par le passé a été prise en otage pour régler des comptes, mais au Zimbabwe, cette ère est révolue nous sommes passés à autre chose ». C’est un important revirement et peut-être le début d’un nouveau chapitre de l’histoire tumultueuse de la terre au Zimbabwe.
RFI