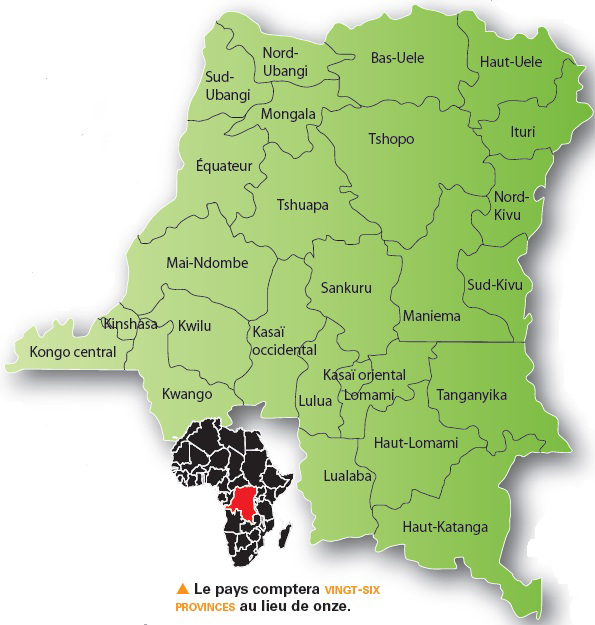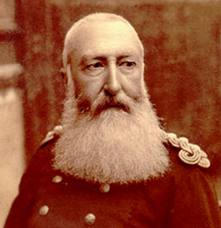-Le peuple congolais est composé de plusieurs centaines d’ethnies — certains donnent le nombre de 450 formant différents groupes. Néanmoins, de nombreuses langues et cultures de petites ethnies ont tendance à disparaître au profit de celles des grosses ethnies.
-Le peuple congolais est composé de plusieurs centaines d’ethnies — certains donnent le nombre de 450 formant différents groupes. Néanmoins, de nombreuses langues et cultures de petites ethnies ont tendance à disparaître au profit de celles des grosses ethnies.
Cette étude démontre que la RDC n’était pas un émiettement de 450 tribus, mais qu’il n’en comprendrait que 250 seulement regroupées, d’après Malcom Guthrie au sein de huit familles linguistiques. En outre ce travail distingue seulement 212 langues en République Démocratique du Congo, dont 34 non bantoues, oubanguiennes ou nilo-sahariennes.
« Les origines des divers groupes ethniques sont variées et consécutives à des vagues de migrations essentiellement bantoues du 1er au 16e siècle. Le terme bantou ne renvoyant pas au départ à un groupe ethnique mais à une communauté linguistique qui couvre la plus grande partie de l’Afrique centrale et australe avec quelques 400 langues apparentées, dites langues bantoues.
Plusieurs légendes existent quant à l’origine exacte du peuple bantou dont le nom vient du mot « ba – ntu » désignant « les (ba: pluriel) hommes (ntu) ». Pour les uns, ce peuple serait originaire du Tchad actuel ou du Nigeria, dans la région où s’est développée la civilisation de Nok. Pour d’autres, le foyer originel serait localisé au sud du Congo sur les plateaux du Katanga. Au début du second millénaire, la découverte de la métallurgie provoque un essor démographique et une longue période migratoire à travers tout le continent. Peuples d’agriculteurs et d’éleveurs, ils repoussent les autochtones, dont les Pygmées au Congo, qui s’isolent dans les forêts denses ou dans les zones plus arides. Les sociétés bantoues se caractérisent par la sacralisation de la personne royale, issue d’un ancêtre mythique ayant découvert l’art de la métallurgie.
Ils ont pénétré le Congo en plusieurs endroits et à plusieurs époques, chassant les peuples préexistants ou se métissant avec eux. Parmi ces premiers occupants, on trouve les Pygmées mais aussi, selon certains auteurs, les semi Bantous qui se distinguent notamment des Bantous par leur filiation à succession matrilinéaire. Ce sont les Bantous qui ont fondé les premiers grands royaumes du Congo. »
Les pygmées Batwas
Il est généralement admis que les chasseurs-cueilleurs, ou Pygmées, sont les premiers habitants des forêts du Congo, ces populations vivaient en autarcie grâce à une économie de cueillette, avant que des groupes d’agriculteurs n’immigrent dans la forêt pendant le premier millénaire.
Ces peuples autochtones s’associent eux-mêmes étroitement à la forêt et font d’elle le centre de leur vie intellectuelle et spirituelle. Ils perçoivent et sont perçus par les populations voisines comme socialement, économiquement, idéologiquement et politiquement différents.
La plupart des populations autochtones de la RDC vivent d’une combinaison de produits forestiers, d’agriculture, de troc et parfois de salaire. Ils entretiennent des relations complexes avec les populations villageoises agricoles, pour qui ils effectuent des travaux ou avec qui ils échangent des biens et des services dont ils utilisent souvent les langues bantoues et soudanaises pour communiquer.
Selon la Ligue Nationale des Pygmées du Congo (LINAPYCO), les pygmées de la RDC se regroupent en trois types: les groupes ‘forestiers’ vivant notamment dans les forêts de l’Ituri; les groupes ‘riverains’ vivant au bord des lacs et rivières spécialement dans l’Equateur et le Kasai; et enfin les groupes ‘potiers’ vivant à l’est du pays dans le Nord et le Sud-Kivu.
Groupe bantou (80 % de la population) :
Luba (18 %),
Mongo (17 %),
Kongo (12 %)
Autres : Ambala,
Ambuun,
Angba,
Babindi,
Bangala,
Bango,
Pende,
Bazombe,
Bemba,
Bembe,
Bira,
Bowa,
Dikidiki,
Dzing,
Fuliru,
Havu,
Hema,
Hunde,
Hutu,
Iboko,
Kanioka,
Kaonde,
Kuba,
Kumu,
Kwango,
Lengola,
Lokele,
Lundas,
Lupu,
Lwalwa,
Mbala,
Mbole,
Mbuza (Budja),
Nande,
NgoliBangoli,
Ngombe,
Nkumu,
Nyanga,
Popoi,
Poto,
Sango,
Shi,
Songo,
Sukus,
Tabwa,
Tchokwé,
Téké,
Tembo,
Tetela,
Topoke,
Ungana,
Vira,
Wakuti,
Yaka,
Yakoma,
Yanzi,
Yeke,
Yela,
Batsamba,
Baholo,
Baboma,
kongo,
yombe… etc.
Groupe soudanique central :
Ngbandi,
Ngbaka,
Manvu,
Mbunja,
Moru-Mangbetu,
Zande,
Lugbara,
Logo Groupe nilotique :
Alur,
Kakwa,
Bari Groupe chamite :
Hima-Tutsi
Groupe pygmée :
Mbuti,
Twa,
Baka,
Babinga
Présentation de la carte ethnique par Région
Les cartes ethniques seront présentées dans l’ordre suivant : le Bas-Congo ; le Kwango-Kasaï, la Cuvette-Centrale et l’Ubangi ; l’Uele-Ituri ; le Kivu-Maniema ; le Nord-Katanga et le sud-Katanga.
1. L’ensemble du Bas-Congo est occupé par l’ethnie Kongo.
Les Vunguna, les Bwende, les Lula et les Humbu sont mêlés à d’autres populations. Les autorités ont refusé de reconnaitre Les Besi Ngombe et les Balenfu car aucun ancêtre commun ne peut être assigné et qu’ils n’ont pas d’identité culturelle pouvant les distinguer de la population environnante, les Ndibu et les Manianga en l’occurrence.
2. Le Kwango, le Kwilu et le Kasaï Occidental
Mbuund et les Pende : les Kuba et les Lulua. On peut y ajouter, au Kwango : les Soonde et les Ciokwe dont la plus grande partie se trouve au Katanga, et au Kasaï ; les Leele, les Luntu et les Kete. Au Kwilu : les Mbala sont une autre grande tribu importante par sa population, mais elle cohabite en de nombreux endroits avec d’autres tribus.
3. Cuvette Centrale
La troisième carte couvre les districts du Maï-Ndombe et de la Tshuapa, ainsi qu’une bonne partie de celui de l’Equateur et de la région Tetela. L’étude révèle que si l’ethnie Mongo a une unité linguistique et culturelle incontestée, les subdivisions y sont nombreuses et peuvent correspondre à des réelles oppositions.
L’ensemble de la région Mongo est ceinturée d’un trait gras, selon la délimitation du Centre équatorial de Bamanya. Les Tetela et les Nkutshu qui appartiennent pourtant à la même famille linguistiquen’y sont pas inclus et sont considérés comme deux groupes distincts, selon l’avis du père Honoré Vinck, qui se distancie en cela du père Gustave Hulstaert.
Au Nord-oeust, avec les Ngombe et les Doko, on trouve comme tribus non Mongo les Bobangi, les Eleku, les Mampko, les Ndobo, les Loi, les Likila, les Ngele, les Bonjo et les Jamba.
Parmi les Mongo, selon le Père Hulstaert, il y a de nombreux groupes Ntomba, Kutu et Nkole. Les tribus indiquées sont, en citant d’abord les plus étendues, à l’Ouest : les Nkundo et les Ekonda, plus à l’est, les Ntomba de l’entre Lopori-Maringa, les Mbole de la Salonga, les Bosaka, les Ngando, les Boyela et les Mbole du Lomami, et au Sud, les Ndengese et les Bokala.
4. L’Ubangi
On trouve des populations de langues non bantoues qui se sont implantées par vagues successives et ont refoulé vers le sud les tribus bantoues qui s’y trouvaient auparavant. Ces mouvements ont affecté les Mongo.
On y est encore en milieu de forêt, mais la marque imposante du fleuve allonge sur ses rives des populations de pêcheurs ou commerçant, les Bobangi, les Ngombe, les Doko, les Mbuja, les Poto et les Lokole notamment.
Dans la région de la Ngiri, entre l’Ubangi et le Congo, on trouve, outre les groupes déjà cités dans la Cuvette centrale les Lolaba, les Tanda, les Mboli, les Ngiri, les Ewaku, les Ndolo, les Lobo, les Makanza, les Ndobo, le Boros Mabembe, les Sengo et les Motembo. Entre la Mongala et Itimbiri, vers la limite de la Province Orientale on trouve les Wenza.
A l’Est d’Itimbiri, on trouve les groupes assez étendus des Binja et des Boa au Nord, des Mbesa et des Topoke au Sud du fleuve. On trouve en outre au sud les Lokole et les Lokele et au nord, les Bango, les Hanga, les Benja, les Binza, les Boro, les Angba, les So (Basoko), les Tungu, les Olombo (Turumbu) et les Mba.
Au Niveau des peuples des langues Oubanguiennes, les grands groupes sont les Ngbaka, les Ngbandi et les Zande, parmi lesquels on distingue les Abandiya des Avungara. Le groupement des Ngbaka sur le plateau de Gemena aurait été organisé par l’administration en 1920.
Il faut y ajouter les Mbanja, les Banda, les Furu et les Nzakara. Les Ngombe présents dans le Nord-Ubangi sont les témoins d’une occupation antérieure de la région par des bantous.
D’autres groupes enclavés le long de l’Ubangi ont des origines diverses, d’amont en aval, les baraka, les Gbanziri, les Ngbaka et les Monjombo.
5. La province Orientale
La Province Orientale reproduit une part de celle de l’Ubangi et souligne ainsi la continuité qui existe entre les deux, malgré leur division administrative.
Au Nord de l’Uele, les Nbgandi, les Zande, les Bangby et les Mayogo appartiennent à la famille oubanguienne.
Il importe de souligner l’originalité du Haut-Uele et de l’Ituri. On y trouve d’une part deux nouvelles familles linguistiques, celle des langues nilotiques, représentées en RDC par les Alur et les Kakwa, auxquelles Jan Vansina joint les Pajulu, et celle dite nilo-saharienne, qui s’étend autour d’Isiro et jusqu’aux frontières du Soudan et de l’Ouganda.
Elle comprend le sous-groupe Mangbetu, qui englobe, outre les les Mangbetu, les Makere, les Malele, les Popoi et les Medje, le sous-groupe Mangutu-Mamvu-Lese, le sous-groupe Logo-Lugbara-Madibari et le sous-groupe Lendu.
On y trouve aussi les Lese, les Nkumu, les Nyari, considérés comme le premier peuple bantou de la région, les Hema, les Banya Rwanda, tant Hutu que Tutsi.
Au caractère particulièrement complexe du Haut-Uele et de l’Ituri, il faut ajouter le découpage ethnique en petites unités de la frontière nord-est du pays on y trouve, outre les groupes déjà cités, les Mundu, les Keliko, les Ndo vare, les Ndo Okebo et les Mabendi, parlant tous des langues de la famille nilo-saherienne.
Les Lombi, formant un groupe enclavé entre les bali et les Kumu, appartiennent aussi à la famille nilo-saharienne, de même que les Mvuba, au Sud des Lese.
Parmi les langues bantoues de la famille D, il faut ajouter aux Nyari et aux Hema déjà cités les Budu, les Ndaka, les Mbo, les Bira, les Père et les Amba. Les Lika semblent par contre apparentés aux Boa et aux Bali de la famille C.
Les Mba en territoire de Banalia et les Dongo en territoire de Faradje sont classées parmi les langues Oubanguiennes.
6. Les deux Kivu et le Maniema
On y repère les Kumu et les Lega (qui sont parmi les plus anciens peuples du Maniema et du Kivu) encadrés, au Nord-ouest par d’autres peuples dont les langues appartiennent à la famille D, les Wagenia, les Lengola, les Metokob et les Songola.
Les Langa, les Ngengele et les Tetela, comme déjà signalé. Au Sud et au Sud-ouest, les Binja, les Bangubangu, les Boyo, les bembe et les Nyitu font partie de la famille D. Les Bembe ont intégré une série de populations, dont les Bwari, bien connus par les noms de la presqu’ile, Ubwari, où les Père blancs ouvrirent leur première mission au Congo en 1880.
Les Shi, représenté en bloc parlent des langues qui, comme le Kinyaranda et le Kirundi appartiennent à la famille J des langues bantoues. Ce sont, du nord au sud, les nande, les Nyanga, les Hunde, les Havu, les Shi et les Fulero, parmi lesquels se trouvent aussi les Vira et des Hundi.
En 1927, le gouvernement du Congo se proposa de créer un mouvement massif de peuplement du Kivu par des rwandais, mais le projet n’aboutit qu’en 1936 à une action qui transplanta dans les Gishari, entre Sake et les Lacs Mokotos, dans le territoire de Masisi, environ 25.000 personnes. L’opération fut suspendue en juin 1945 pour saturation (…).
7. Le Nord-Katanga, le Kasaï-Oriental
En descendant au sud du 4ème parallèle, on constante la réapparition des zones de cohabitation. Il n’est pas exclu que la population s’y est formée par vagues successives qui se sont superposées.
Sur base d’une série d’indices, les Kete au Kasaï et les Kunda au Katanga sont unanimement considérés comme des couches les plus anciennes du peuplement.
Les Kete, dont on retrouve des groupes de la région Kuba à celle de Lwalwa et des Kanyok, auraient été suivis au Tumbwe par les Lulua et les Kanyok, puis par les Bakwa Luntu du territoire de Dimbelenge, dont on retrouve aussi un groupe plus à l’Ouest, et enfin par les Luba du Kasaï. Tous provenaient d’un foyer de population extrêmement ancien implanté au Katanga.
Au Kasaï Oriental, outre les groupes cités ci-haut, le groupe des Songye, les Binji, les Mputu et, en cohabitation dans le territoire de Mwene-ditu, les Kanincim, qui font partie du monde Lunda.
Au Katanga, des groupes importants de Kunda existent tant au Nord, dans le territoire de Kongolo, qu’au sud, dans celui de Kasenga, mais il y en a toute une série d’autres entre ces deux extrêmes, soit isolés, soit associés à des Hemba, des Bangubangu, des Bayo, des Luba, des Lumbu…
Les Luba katanga sont le groupe de plus important au Katanga, suivis en bordure du Lac Tanganyika, par les Tumbwe et les Tabwa, adossées aux Bwile. A l’Ouest, les Lunda et les Kalundwe sont deux autres groupes importants.
8. Le Sud-Katanga
On a à l’Ouest, les Lwena, les Ndembo et les Minungu. La partie orientale est plus complexe. On y trouve, du nord au sud, les Zela, les Lomotwa, les Sanga, les Kaonde, les Lemba et les Lamba, comme les groupes les plus étendus, avec en outre les Bemba, les Shila, les Nwenshi, les Lembwe, les Ngoma, les Seba, les Aushi et les Lala, qui occupent aussi des territoires plus vastes que de nombreuses tribus dans la province.
Liste des ethnies et tribus par territoire de la RDC
Ethnies/Tribus Territoire
Abandiya – Aketi,Bondo, Buta
Abarambo – Poko
Aka (pygmées) – Dungu
Alur – Mahagi
Amadi – Poko, Nyangara
Amba – Beni
Angba – Banaliya
Apagibeti – Bumba, Businga, Yakoma
Aushi- Kipushi, Sakania
Avungara – Dungu, Nyangara
Beanga – Bolomba
Bale – Cfr Lendu
Bali – Bafuasende
Bali-ndua- Lisala
Balobo – Bomongo
Banda – Bosobolo, Libenge
Bangba – Nyangara, Watsa
Bango – Basoko
Bangubangu – Kabalo, Kabambare, Kasongo, Kongolo, Nyunzu
Banya Bwisha – Rutshuru
Bari – Watsa
Bemba – Kasenga, Pueto
Bembe – Fizi, Mwenga
Benja – Basoko
Binja – Aketi, Kasongo
Binja sud – Kasongo, Pangi, Punya
Binji – Demba, Dimbelenge, Lusambo
Binza – Aketi, Bambesa, Banalia, Bondo, Buta
Bira – Irumu, Mambasa
Boa – Aketi, Bambesa, Banalia, Bondo, Buta
Bobai – Oshwe
Bobangi – Bomongo
Bofonge – Djolu
Boguru – Yakoma
Bokala – Oshwe
Bokongo – Oshwe
Bokote (Nord)- Bansakusu, Bikoro, Bolomba, Ingende, Mokoto
Bolia – Inongo
Boloki – Bomongo
Boma – Bagata, Mushi
Bonjo – Bomongo
Boonde – Bongandanga, Djolu
Boro – Banaliya
Bosaka – Befale, Bokungu
Boyela – Ikela, Lomela
Boyo – Fizi, Kabalo, Kabambare, Manono, Nyunzu
Budu – Mombasa, Wamba, Watsa
Bwari – Fizi
Bwende – Luozi
Bwile – Moba, Pweto
Ciokwe – Dilolo, Feshi, Ilebo, Kehema, Kansongolunda, Popokabaka, Sandoa, Tshikapa
Dikidiki – Kimvula, Madimba, Popokabaka
Dinga – Tshikapa
Doko – Budjala, Lisala
Dongo – Faradje
Dza – (Badia) Kutu
Dzing – Idiofa
Efe (Pygmées) – Irumu, Mambasa, Watsa
Ekonda – Bikoro, Ingende, Inongo, Kiri
Ekota – Boende
Eleku – Bomongo, Makanza
Ewaku – Bomongo
Fulero – Uvira
Fulru – Bosobolo
Gbanziri – Bosobolo
Gboma – Yakoma
Gbuta – Aketi
Hamba – Lodja, Lomela
Hanga – Basoko, Isangi
Havu – Kalehe
Hema – Beni, Djugu, Irumu
Hemba – Kabambare, Kasongo, Kongolo, Malembankulu, Manono, Nyunzu
Holo – Kasongo Lunda
Humbu – Bagata, Kansangulu, Kenge, Kinshasa
Hunde – Masisi, Rutsuru
Hungaan – Bagata, Bulungu, Kenge, Masimanimba
Ikongo – Bokungu
Imoma-Mpongo- Monkoto
Ionga (Djonga) – Lomela
Ipanga – Oshwe
Iyembe – Inongo
Jaba – Kungu
Jamba (Djamba)- Bomongo
Kakongo – Boma, Lukula
Kakwa – Aru, Fardje
Kalanga – Nyunzu
Kalundwe – Kamina, kaniama
Kango – Aketi, Buta, Nyangara
Kanyok – Mweneditu
Kaonde – Kambove, Lubudi, Mutshatsha
Keliko –
Aru Kete – Libalya, Kamiji, Luebo, Luiza, Mweneditu, Mweka, Tshikapa
Kuba – Ilebo, Luebo, Mweka
Kula – Makanza
Kumu – Bafuasende, Lubutu, Pangi, Ubundi, Walikali
Kunda – Kabalo, Kasenga, Kongolo, Malembankulu, Manono, Moba, Nyunzu, Pweto
Kusu – Kasongo, Kibombo, Kongolo
Kutu – Boende, Goma, Rutshuru
Kwese – Gungu
Lala – Sakania
Lamba – Kambove, Kasenga, Kipushi, Sakanya
Langa – Kindu
Leele – Idiofa, Ilebo, Luozi
Lega – Mwenga, Pangi, Punia, Shabunda, Walikale
Lemba – Kambove
Lembwe – Kasenga
Lendu (Bale)- Djugu, Irumu, Mahagi
Lengola- Kindu, Ubundu
Lese – Irumu, Mambasa, Watsa
Libinza – Bomongo, Makanza
Lika – Wamba
Likila – Bomongo
Lionje – Boende
Lobala – Bomongo, Kungu
Lobo – Makanza
Logo – Faradje
Loi – Bomongo
Lokele – Isangi
Lokole – Bokungu, Yahuma
Lombi – Bafuasende
Lomotwa – Mitwaba
Luba Kas – Bemba, Dibaya, Ilebo, Kabeya-Kamwanga, Kamiji; Katanda, kazumba, Luebo, Lupatapata, Lusambo, Miabi, Mueneditu, Mweka, Ngandajika, Tshikapa, Tshilenge
Luba Kat – Bukama, Kabalo, Kabambare, Kabinda, Kabongo, Kamina, Lubudi, Malembankulu, Mutshatsha, Sandoa
Lugbare – Aru
Lula – Limvula, Madimba, Popokabaka
Lulua – Demba, Dibaya, Kazumba, Luebo, Tshikapa
Lumbu – Kabalo, Kalemi, Kongolo, Manono, Nyunzu
Lunda – Dilolo, Gungu, Kahemba, Kapanga, Lubudi, Mweneditu, Mutshatsha, Sandoa, Tshikapa
Luntu (Bakwa)- Demba, Dimbelenge
Lusankanyi – Lukolela
Lusengo – Makanza
Lwalwa – Kazumba, Luiza, Tshikapa
Lwena – Dilolo
Lwer – Idiofa
Mabembe – Makanza
Mabendi – Djugu
Madi – Aru
Makanza – Makanza
Makere – Bambesa
Malele – Poko
Mampoko – Bomongo, Makanza
Mamvu – Dungu, Watsa
Mangbetu – Niangara, Rungu, Wamba
Mangutu – Watsa
Manianga – Luozi, Mbanzangungu
Mate – Luberu
Mayogo – Niangara, Rungu
Mba – Banaliya
Mbagani – Kazumba
Mbai – Luiza
Mbala – Bagata, Bulungu, Fetshi, Gungu, Kazumba
Mbanja – Bosobolo, Budjala, Businga, Kunga, Libenge
Mbata – Madimba, Mbanzangungu
Mbeko – Madimba, Mbanzangungu
Mbelo (Ekonda) – Oshwe
Mbesa – Basoko, Yahuma
Mbikiankamba – Oshwe
Mbinsa – Kasangulu
Mbo – Mambasa
Mbole – Boende, Isangi, Mokoto, Opala
Mboli – Kungu
Mboma – Songololo
Mbuja – Bumban Lisala
Mbuli – Katakokombe
Mbuti (pygmies)- Aru, Djugu, Idiofa
Mbunda – Bulungu, Gungu, Idiofa
Medje – Rungu
Metoko – Ubundu
Mfunu – Mushie
Minungu – Kahemba, Kasongolunda, Sandoa
Mondumba – Bumba
Mondjombo – Libenge
Motembo – Budjala, Lisala
Mpama – Lukolela
Mpangu – Kasangulu, Kinvula, Madimba, Mbanzangungu
Mpe -Inongo
Mpoko – Bomongo
Mputu – Lusambo
Mundu – Faradje
Mvuba – Beni
Nande – Beni, Lubero
Ndaka – Mambasa
Ndembo – Dilolo, Kamina, Lubudi, Mutshatsha
Ndengese – Dekese
Ndibu – Kasangulu, Mbanzangungu, Songololo
Ndo Okebo – Aru
Ndo Vare – Aru
Ndobo – Bomongo, Makanza
Ndunga – Lisala
Ngando – Bokungu, Djolu, Ikela, Yahuma
Ngbaka – Businga, Gemena, Kungu, Libenge
Ngbandi – Bondo, Budjala, Businga, Gemena, Kungu, Mobayimbongo, Yakoma
Ngele – Bomongo
Ndengele – Kindu
Ngenja – Lisala
Ngiri – Kungu
Ngoma (Bena)- Kasenga
Ngombe – Basankusu, Bolomba, Bongandanga, Bosobolo, Budjala, Kungu, Lisala
Ngongo – Bagata, Bulungu, Kenge, Masimanimba
Ngul – Idiofa
Nkanu – Kimvula, Madimba, Popokabaka
Nkole – Kiri
Nkundo – Bansakusu, Bikoro, Bolomba, Ingende, Mokoto
Nkutshu – Nkole
Nsongo – Befale
Ntandu – Kasangulu, Madimba
Ntomba – Befale, Bikoro, Bongandanganda, Inongo
Nunu – Lukolela
Nwenshi – Mitwaba
Nyanga – Walikale
Nyari – Djugu, Mahagi
Nyintu – Mwenga
Nzakara – Bondo
Okebo (Ndo) – Djugu, Mahagi
Olombo (Turungu)- Basoko, Isangi
Ombo – Kindu
Ooli – Kole, Oshwe
Pajulu – Faradje
Pende – Feshi, Gungu, Idiofa, Kahemba, Tshikapa
Père – Lubero
Pindi – Bulungu
Popoji – Bambesa, Banalia
Poto – Basoko, Bumba, Lisala, Makanza
Rundi – Uvira
Sakata – Kutu
Salampasu – Luiza
Sanga – Kambove, Lubudi
Sengo – Makanza
Seba – Kipushi
Sengele – Inongo
Shi – Kabare, Kalehe, Mwenga, Walungu
Shila – Pweto
Shunji – Kahemba, Kasongolunda
Shoowa – Mweka
Shu- Beni
So (Basoko) – Basoko, Isangi
Solongo – Boma, Lukula
Songola – Kindo
Songomeno – Mokoto
Songye – Demba, Kabalo, Kabinda, kabongo, Kasongo, Kongolo, Lodja, Lubao, Lubefu, Lusambo, Ngandajika
Soonde – Fashi, Kahemba
Sua (Pygmées) – Itumu, Mambasa
Suku – Bulungu, Feshi, Luozi, Mbanza-ngungu, Tshela
Sundi – Kasangulu, Lukusa, Luozi, Mbanzangungu, Tshela
Swaga – Lubero
Tabua – Moba
Tanda – Bomongo, Kungu
Tangi – Beni, Lubero
Teke – Bolobo, Kasangulu, Mushie
Tere (Sakata) – Kutu
Tetela – Demba, Katakokombe, Kole, Lodja, Lomela, Lubao, Lubefu, Lusambu
Tiene – Bolobo
Titu – Oshwe
Topoke – Isangi
Tow – Kutu
Tsamba – Bulungu, Feshi, Kasongolunda, Kenge, Masimanimba, Popokabaka
Tsong – Bulungu, Masimanimba
Tumbwe – Kalemi, Manono, Moba
Tungu – Banaliya
Vira – Uvira
Vungana – Lukula, Sekebanza
Wagenya – Kasongo, Katakokombe, Kindu, Kongolo, Mambesa, Ubundu
Watambulu – Katakokombe
Wenze – Budjala, Lisala
Wongo – Gungu, Ilebo
Woyo – Boma
Yaka – Kasongolunda, Kenge, Popokabaka
Yansi – Bagata, Bulungu, Kenge, Masimanimba
Yeke – Kasenga, Lubudi, Pweto
Yew – Bambesa, Buta
Yira (Nande) – Beni, Lubero
Yombe – Boma, Lukula, Sekebanza, Tshela
Zande – Ango, Bambesa, Poko
Zela – Mitwaba, Pweto
Zombo