 Le remdesivir écourte la durée de rétablissement des patients atteints du Covid-19, selon une étude menée par les Instituts de santé américains, devenant le premier médicament ayant prouvé son efficacité contre le nouveau coronavirus.
Le remdesivir écourte la durée de rétablissement des patients atteints du Covid-19, selon une étude menée par les Instituts de santé américains, devenant le premier médicament ayant prouvé son efficacité contre le nouveau coronavirus.
Qu’est-ce que le remdesivir?
Le remdesivir est un médicament expérimental produit par le laboratoire américain Gilead Sciences, qui a initialement été développé pour soigner les malades de la fièvre hémorragique Ebola.
Il s’était montré prometteur lors d’essais en 2016, et avait été ensuite testé lors d’une étude de grande ampleur en République démocratique du Congo, qui le comparait à trois autres traitements.
Cette étude s’est achevée en 2019 et n’a pas conclu que le médicament permettait une augmentation du taux de survie aussi importante que celle de deux autres traitements.
En février, l’Institut national des maladies infectieuses annonçait qu’il allait sortir le remdesivir du placard pour le tester contre le virus SARS-CoV-2, à l’origine de la maladie Covid-19, car il avait donné des résultats prometteurs chez les animaux contre d’autres coronavirus, du SRAS (Syndrome respiratoire aigu sévère) et MERS (Syndrome respiratoire du Moyen-Orient).
Quelle est son efficacité ?
Les résultats de cette étude, sur plus d’un millier de personnes, ont été annoncés mercredi, avec pour conclusion que les patients hospitalisés atteints du Covid-19 et en détresse respiratoire se remettaient plus vite que ceux recevant un placebo.
Plus précisément, les patients soignés au remdesivir se sont rétablis 31% plus vite en moyenne que les autres.
« Bien que les résultats étaient clairement positifs du point de vue de leur sens statistique, ils étaient modestes« , a nuancé jeudi sur NBC le directeur de l’Institut national des maladies infectieuses, Anthony Fauci, qui conseille la Maison-Blanche dans ce contexte de crise.
En clair, même si le médicament marche, il ne s’agit pas d’un remède miracle.
Mais c’est cependant la « démonstration » qu’un médicament peut agir, et il pourrait donc ouvrir la voie à de meilleurs traitements. Comme cela a été le cas pour les traitements contre le VIH développés dans les années 1980, beaucoup moins efficaces que ceux utilisés aujourd’hui.
Les résultats ont aussi montré que le remdesivir abaissait le taux de mortalité – de 11,7% à 8% – mais cette donnée est considérée comme moins fiable car en dessous du niveau de pertinence statistique.
Pourquoi y a-t-il eu des résultats contrastés?
L’étude menée par les Etats-Unis a été annoncée le même jour qu’une autre étude plus petite publiée dans la revue médicale The Lancet, qui n’a pas conclu à un résultat bénéfique du remdesivir.
L’étude a porté sur 237 malades à Wuhan, en Chine, et était également un essai contrôlé randomisé, considéré comme la norme d’étude la plus élevée. Mais elle a été interrompue faute de malades car l’épidémie s’est arrêtée à Wuhan.
« Les ordres de grandeur de cet essai sont trop petits pour en tirer de vraies conclusions« , a jugé Stephen Evans, expert en statistique médicale à la London School of Hygiene & Tropical Medicine.
Quand sera-t-il disponible?
Le remdesivir a déjà été donné à des patients du monde entier, à la fois dans le cadre d’essais cliniques et en dehors.
Aux Etats-Unis, l’Agence américaine du médicament (FDA) devrait bientôt accorder une autorisation d’utilisation d’urgence, c’est-à-dire avant son approbation formelle.
Le chef de l’agence « avance très rapidement », a déclaré jeudi M. Fauci, qui a dit lui avoir parlé mercredi soir. « Ils n’ont pas encore pris de décision (…) mais je dirais que nous allons voir cela dans un avenir raisonnablement proche. »
Le médicament étant compliqué à produire et étant administré par injection, des questions ont été soulevées quant à d’éventuelles restrictions initiales.
Le patron de Gilead Sciences, Daniel O’Day, a annoncé que le laboratoire disposait actuellement de 1,5 million de doses, dont il s’est engagé à faire don, permettant de traiter 140.000 patients « sur la base d’un traitement d’une durée de dix jours« .
Mais selon une autre étude, un traitement de cinq jours serait aussi efficace que dix jours.
Comment fonctionne-t-il?
Le remdesivir attaque directement le virus. C’est ce que l’on appelle un « analogue de nucléotide ». Il s’insère dans le génome du coronavirus et le court-circuite pour l’empêcher de se répliquer.
« Le virus ne fait pas très attention à ce qu’il incorpore« , explique le virologue Benjamin Neuman, de la Texas A&M University. « Les virus essaient généralement d’aller vite, et échangent rapidité contre prudence« .
Durant une conférence téléphonique sur les résultats du groupe, le responsable médical de Gilead, Merdad Parsey, a expliqué jeudi que si les patients qui avaient des symptômes depuis peu de temps semblaient réagir le mieux au médicament, ceux qui étaient dans des états plus critiques semblaient aussi pouvoir en tirer des bénéfices.
Cela s’explique car le virus déclenche un emballement de la réaction immunitaire, phénomène nommé « tempêtes de cytokine » s’attaquant aux organes, notamment aux poumons.
« En limitant la réplication du virus, on va limiter l’inflammation, on va réduire le nombre de personnes qui développent des problèmes aux poumons, et on va pouvoir les débrancher des respirateurs plus rapidement« , a détaillé M. Parsey.
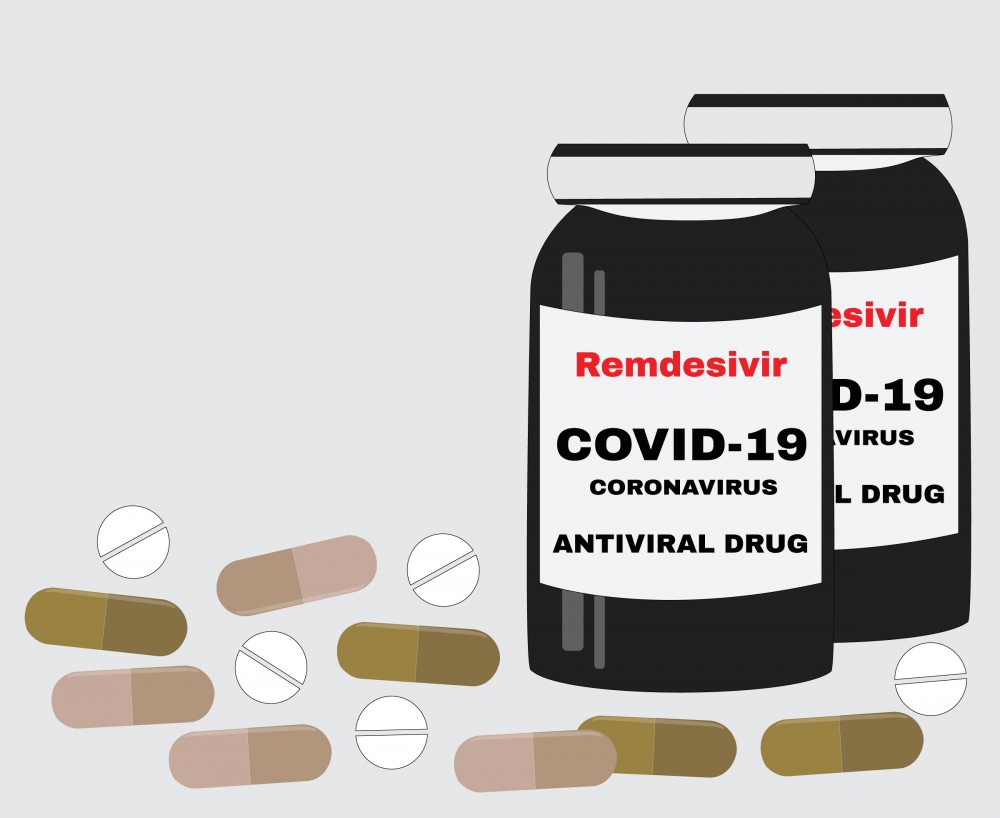




![[Tribune] L’incontournable vaccin, entre défis et paradoxes](https://lavdc.net/wp-content/uploads/2019/01/31317/tribune-lrsquoincontournable-vaccin-entre-defis-et-paradoxes.jpg)


