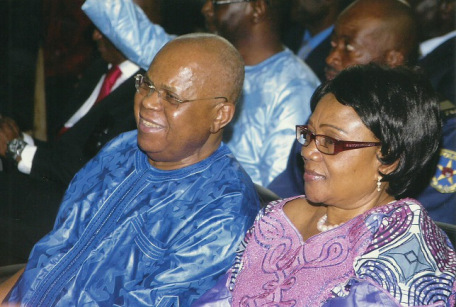-De passage à Paris, Ida Saywer, directrice pour l’Afrique centrale de Human Rights Watch, est revenue vendredi pour Jeune Afrique sur les derniers rebondissements de la situation sécuritaire et politique en RDC, mais aussi sur l’état des droits de l’Homme dans le pays. Interview.
-De passage à Paris, Ida Saywer, directrice pour l’Afrique centrale de Human Rights Watch, est revenue vendredi pour Jeune Afrique sur les derniers rebondissements de la situation sécuritaire et politique en RDC, mais aussi sur l’état des droits de l’Homme dans le pays. Interview.
Cela va faire bientôt 10 ans depuis qu’elle travaille sur la RD Congo. Jusqu’à peu, elle était même la représentante de Human Rights Watch dans le pays, avant d’être nommée, fin octobre, directrice pour l’Afrique centrale de l’ONG internationale des droits de l’Homme. Mais c’est désormais depuis Bruxelles qu’Ida Sawyer observe ce qu’il se passe en RD Congo. Et pour cause : en janvier dernier, elle a été reconduite à la frontière et son visa annulé. De passage à Paris, Ida Saywer a accepté de répondre aux questions de Jeune Afrique.
Jeune Afrique : Après l’annulation de votre visa en janvier par les autorités congolaises, peut-on dire que vous êtes persona non grata en RD Congo ?
Ida Sawyer : Officiellement, je n’ai pas reçu le statut de persona non grata. Les autorités congolaises ont refusé de renouveler mon visa en août. J’ai pu avoir un visa par la suite, mais une semaine après mon arrivée dans le pays en janvier il a été annulé. Pour Kinshasa, je suis un cas spécial. Il me faut donc une autorisation spéciale, que je n’ai toujours pas reçue pour pouvoir rentrer en RD Congo.
On assiste à une aggravation horrible de la situation des droits humains en RD Congo
Après votre départ, le pays a connu ces derniers mois une recrudescence d’actes de violences, caractérisée notamment par des affrontements au Kasaï, des attaques ciblées des parquets…
Depuis mon départ en août, on assiste en effet à une aggravation horrible de la situation des droits humains à travers le pays. La répression politique se poursuit. Des arrestations des activistes, des étudiants, des opposants et de leurs proches nous sont signalées chaque jour. De fait, les mesures de décrispation voulues par l’accord de la Saint-Sylvestre n’ont presque pas été appliquées jusqu’à aujourd’hui.
Aussi faut-il souligner que la situation sécuritaire au Kasaï est très alarmante à cause de la force excessive utilisée par les forces de sécurité déployées dans la région et de la violence des éléments de Kamuina Nsapu mais aussi d’autres milices qui sont soutenues par le gouvernement. Pis, aujourd’hui, nous ne voyons pas suffisamment de volonté politique de la part des autorités congolaises pour mettre fin à cette violence.
Le RD Congo se dirige vers la militarisation de la police
Comment interprétez-vous la récente décision du président Joseph Kabila de remplacer le commissaire général de la police national et celui en charge de la ville de Kinshasa ?
Symboliquement, ces remplacements démontrent que le pays se dirige vers la militarisation de la police. Le fait de nommer comme commissaire général de la police un officier qui était chef d’état-major adjoint chargé des opérations au sein de l’armée, c’est un très mauvais signal. Cela voudrait dire que les forces de la police qui ont une responsabilité de protéger la population et de maintenir l’ordre public sont désormais contrôlés par un militaire. Et ces nominations sont intervenues deux jours après la sortie médiatique de Patrick Nkanga, président de la jeunesse du PPRD [Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, au pouvoir] qui a préconisé l’instauration d’un état d’urgence en RD Congo.
Pensez-vous que ces nominations à la tête de la police peuvent être vues comme une première étape vers l’instauration d’un état d’urgence dans le pays ?
Il nous semble en effet que c’est un pas vers l’état d’urgence. Notre inquiétude est que cette éventuelle instauration de l’état d’urgence ne soit utilisée pour justifier plus de répression, plus d’interdiction de manifester, plus de restriction à la liberté d’expression et ne constitue une nouvelle excuse pour retarder davantage le processus électoral.
À Genève pourtant, le groupe africain a retenu la RD Congo comme future membre du Conseil des droits de l’homme. Comprenez-vous ce soutien ?
C’est une grande déception. Au moment où l’on assiste à cette aggravation de la situation des droits de l’homme au pays, y compris des violences perpétrées par les forces de sécurité gouvernementales, nous ne pensons pas que la RD Congo mérite une place aujourd’hui au sein du Conseil des droits de l’homme.
Y-a-t-il une issue à la crise politique en cours en RD Congo ?
Ce qui manque aujourd’hui c’est une volonté politique réelle d’organiser les élections et d’assurer une transition pacifique et démocratique à la tête du pays. Jusqu’ici, le président Kabila n’a pas montré un signal pour dire qu’il est prêt à partir. On assiste plutôt à une excuse avancée après l’autre pour retarder le processus électoral.
Les sanctions internationales contre les proches de Joseph Kabila peuvent-elles constituer un moyen de pression efficace pour faire aboutir à ce processus démocratique ?
Les sanctions ciblées jouent un rôle important. Elles démontrent qu’il y a des conséquences personnelles pour tous ceux qui sont impliqués dans les violences et à la répression politique. Nous espérons qu’elles peuvent aider à dissuader la commission d’autres violences et à convaincre certaines autorités de ne pas continuer dans la même dynamique. Contrairement au Burundi, les autorités congolaises voyagent beaucoup à Paris, Bruxelles, Londres voire aux États-Unis. Beaucoup de leurs membres de familles habitent ou étudient à l’étranger. Les sanctions internationales les affectent donc personnellement.
C’est inquiétant d’utiliser la Garde républicaine à des fins privées
En attendant, des révélations s’enchaînent ces dernières semaines sur l’immense fortune de la famille Kabila…
Il en ressort un manque de transparence presque totale dans la gestion des affaires de la famille présidentielle. Ce qui nous inquiète, à Human Rights Watch, c’est aussi l’utilisation de la Garde républicaine à des fins privées, en occurrence pour protéger les biens (champs, mines,etc.) des membres de la famille présidentielle.
Toutes ces révélations démontrent aussi que la famille Kabila possède énormément d’intérêts financiers au pays. Cela peut être l’une des raisons qui poussent le président à s’accrocher au pouvoir. C’est un élément très important à prendre en compte dans l’analyse des voies de sortie de crise en RD Congo.
Faudrait-il garantir à Joseph Kabila une certaine immunité ?
Ce n’est pas à Human Right Watch de faire une telle proposition. Nous essayons plutôt de comprendre pourquoi le président Joseph Kabila ne veut pas quitter le pouvoir. La richesse qu’il a accumulée au pouvoir constitue donc un élément important de l’analyse.
Avec JA