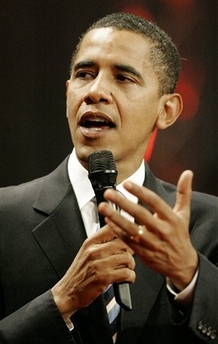-Chers camarades et chers amis. Nous avons l’honneur et l’amitié de nous adresser à ceux d’entre vous, partisans de la thèse selon laquelle le Président de la République à la fin de son 2e mandat devrait pouvoir en solliciter un 3è; ce qui suppose la révision des articles 57, 185 et à titre subsidiaire, de l’article 58 de la Constitution du 20 janvier 2002. C’est un besoin d’innovation qui correspond à des aspirations que nous respectons, même si, ni le PCT en tant que parti majoritaire au Parlement ni le Président de la République qui a vraisemblablement le temps d’attendre, n’ont pas encore pris la parole de façon officielle à ce sujet. Il nous sied de souligner en passant que l’opposition dite radicale s’oppose fermement à ce 3e mandat. Elle rejette d’emblée la modification des articles 57 et 185 de la Constitution relatifs au nombre de mandats tel que vous l’envisagez. Il est regrettable de constater que cette opposition demeure une opposition de principe qui n’est expliquée nulle part, sinon par des discours dogmatiques qui ne sont pas de nature à créer un climat propice au dialogue que nous sommes tous en droit d’attendre.
-Chers camarades et chers amis. Nous avons l’honneur et l’amitié de nous adresser à ceux d’entre vous, partisans de la thèse selon laquelle le Président de la République à la fin de son 2e mandat devrait pouvoir en solliciter un 3è; ce qui suppose la révision des articles 57, 185 et à titre subsidiaire, de l’article 58 de la Constitution du 20 janvier 2002. C’est un besoin d’innovation qui correspond à des aspirations que nous respectons, même si, ni le PCT en tant que parti majoritaire au Parlement ni le Président de la République qui a vraisemblablement le temps d’attendre, n’ont pas encore pris la parole de façon officielle à ce sujet. Il nous sied de souligner en passant que l’opposition dite radicale s’oppose fermement à ce 3e mandat. Elle rejette d’emblée la modification des articles 57 et 185 de la Constitution relatifs au nombre de mandats tel que vous l’envisagez. Il est regrettable de constater que cette opposition demeure une opposition de principe qui n’est expliquée nulle part, sinon par des discours dogmatiques qui ne sont pas de nature à créer un climat propice au dialogue que nous sommes tous en droit d’attendre.
Les deux points de vue diamétralement opposés peuvent ou ne pas servir la cause de la paix qui nous est à tous si chère. Donnons le temps au temps, pourvu que la démocratie en sorte sauve et renforcée. Nous nous adressons à vous pour que notre pays ne s’enfonce pas dans l’impasse qui se profile à l’horizon, impasse qui résultera à coup sûr d’un affrontement non souhaitable mais prévisible entre les forces qui dominent notre scène politique nationale, et qui s’inscrivent tout naturellement dans cette logique. C’est en ce sens qu’une 3e voie s’impose. Elle seule peut ouvrir au pays un espace de conciliation politique et de consensus nécessaire à la construction nationale dans cette phase de balbutiements démocratiques. Nous nous adressons à vous pour plaider cette cause qui nous est commune : Une contribution au débat en cours sur la révision des articles 57 et 185 de notre Constitution. Le débat théorique sur ces points n’est pas le fond du problème, quelle que soit la pertinence des arguments des uns et des autres. Le problème, est de savoir, quelle procédure allons-nous modifier les articles 57 et 185, notamment l’article 185 qui constitue un barrage infranchissable avant la révision de l’article 57. Le droit applicable dans notre pays est celui que traduit en tout premier lieu la Constitution du 20 janvier 2002. Elle est la seule référence qui nous permet de circonscrire le problème de la révision des articles 57 et 185, Pour éviter toute confusion et rendre plus complexe un problème au demeurant simple dans sa lecture, Il serait souhaitable de ne pas sortir de ce cadre. Nous devons retenir en conséquence que si tous les articles d’une
Constitution sont en général révisables, la Constitution congolaise fait exception à cet égard. En effet, qu’il soit dit une fois pour toute que l’article 1er sur la forme républicaine et le caractère laïc de l’Etat, l’article 57 sur la limitation à deux, du nombre de mandats présidentiels ainsi que les droits énoncés aux titres 1 & 2 ne sont pas révisables. C’est l’exception que vous trouverez à l’article 185 de la même Constitution.
Dans le cadre de la République ou de l’ordre interne, l’article 185 est donc opposable à tous ceux qui estiment que l’article 57 est révisable peu importe le bien-fondé de leurs arguments. Ce constat nous place devant trois hypothèses : La première est celle suivant laquelle toute modification de l’article 185 qui ouvre la voie à la modification de l’article 57 n’est possible qu’en cas de changement de constitution. Ce qui serait ni plus ni moins un coup d’Etat constitutionnel. La deuxième hypothèse serait que la classe politique dans une forme qui reste à trouver règle par consensus la question de la modification des articles 185 et 57. Dans ce cas, le gouvernement fort de ce consensus peut franchir la barrière de l’article 185 et s’adresser au peuple sur la modification par voie référendaire de l’article 57. Il convient de remarquer que cette solution n’a aucune chance de réussir quand on observe les prises de position tranchées de l’opposition et de la majorité sur ce point. La troisième hypothèse, la plus conforme à la présente Constitution, c’est d’observer le statu quo. Il faut néanmoins souligner que l’opposition n’a pas raison d’étendre ce statu quo à toute la Constitution. C’est de la surenchère politicienne. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’en la nation, la mise en
œuvre de toute procédure .pour modifier les articles 57 et 185 est plutôt laborieuse. Elle peut susciter comme un doute sur ce qu’il y a de mieux à faire. Ce doute tout naturellement ne peut que profiter au statu quo et à la stabilité politique qu’il suggère, stabilité à laquelle nous aspirons tous.
Même si un consensus fondé et légitime était réuni dans le pays sur la révision des articles concernés, ou sur le maintien de ces articles, on n’oublierait pas le caractère à la fois juridique et politique de cet acte. C’est dire que la révision des articles évoqués plus haut se heurte à deux grands obstacles : le premier fondamentalement juridique et le second éminemment politique. Sur ce second plan, c’est l’absence d’opportunité de modifier sans encombre les dispositions sus visées de la Constitution qui pose problème. Examinons la non-opportunité de la révision de l’article 57 notamment: N’est-il pas judicieux sur ce plan, que l’article 57 demeure en l’état ? Ce n’est pas le seul cas où l’application d’une loi dans la société pose un problème d’inopportunité qui laisse celle-ci inappliquée « C’est le cas de la Loi sur la peine de mort ». Elle existe dans bon nombre de pays où elle n’est plus appliquée, tout juste parce qu’une majorité dans l’opinion considère que la peine de mort a quelque chose de moralement inadmissible et que, au-delà, elle ne contribue pas à la diminution de la criminalité comme on pouvait s’y attendre. Ceci montre la relativité de l’application de la loi. C’est dans cet
esprit qu’il faut retenir ce que nous appelons opportunité de la révision de tel ou tel article de la Constitution. Nous plaidons donc devant vous, la non-révision des articles 57 et 185, à la fois pour des raisons juridiques, mais aussi pour des raisons d’opportunité politique. Nous référant aux points de vue soulevés par certains dirigeants du PCT, certains membres du Gouvernement ou simplement tous les citoyens intéressés par la question, nous constatons qu’il s’agit des idées unilatérales qui engagent le gouvernement malgré lui et qui nous interpellent. Nous pensons qu’il faut pouvoir les contenir, pour ne pas laisser prévaloir une opinion unilatérale sortant d’un seul « foyer» avec tous les préjugés qu’elle suscite dans les autres foyers d’opinion qui ne manquent pas. C’est de l’intérêt de tous de ne pas remplacer un débat serein, intelligent et éclairant par la propagande du PCT que vont nécessairement renforcer celles des organisations de masse du PCT en cours de création qui ont toujours su faire ce qu’ils doivent faire en pareille circonstance. Une telle approche, si elle avait lieu, ne serait pas loin de ce que le président actuel du PCT appelait à son temps «démocratie de l’intimidation » qui n’a pas encore perdu toutes ses lettres de noblesse. Nous savons tous que notre pays aspire à la démocratie. Ce que personne ne conteste. «La limitation du nombre de mandats présidentiels » est un acquis historique, qui tire sa source de la première Constitution post-conférence nationale de 1992. On peut dire aujourd’hui que cette disposition a résisté au temps, qu’elle mérite notre considération et ce n’est pas un hasard si les constitutionalistes de 2002 l’ont placée à I’abri des prédateurs en édictant l’article 185.
Les points de vue des dirigeants du PCT et de certains membres du gouvernement qui prêchent la révision de l’article 57, relèvent du paradoxe. Pour nous, l’article 57 est un acquis historique qui doit encore avoir de beaux jours devant lui. Souhaitons-lui une exceptionnelle pérennité parce qu’elle est sans conteste de nos jours d’actualité. Les divergences qui s’annoncent dans I’opinion et les risques qui peuvent éventuellement en découler, nous déconseillent de persévérer dans cette fuite en avant de l’opposition et du pouvoir. C’est loin d’être la solution. Il faut trouver la bonne pédagogie… Il convient aussi de retenir que la Constitution d’un pays est comme un costume prêt à porter. S’il vous va, vous le portez et lorsqu’il ne vous va pas vous le laissez tomber. Il n y a pas d’autres choix. Pour le besoin de la cause, on peut donc écarter et délégitimer toute démarche politique tendant à réviser l’article 57, révision dont l’issue est incertaine. Ne pas le comprendre, c’est faire courir au pays un risque qui peut malheureusement devenir un risque de trop. Nous avons évoqué le risque; disons simplement qu’à la lumière de notre histoire depuis l’indépendance, notre pays en lui-même est un gros risque. Lorsque nous parlons de notre pays le Congo-Brazzaville, nous devons savoir de quoi l’on parle. Situons-le par rapport à son histoire pour voir de quoi est construite notre mémoire collective. Un peuple a besoin nécessairement des référents. Notre histoire nous renseigne que nous avons connu quatre grands moments décisifs, mais aussi explosifs qui ont marqué notre pays de façon
indélébile en un demi-siècle. On peut les retenir suivant cet ordre : – Au commencement il y a eu une guerre civile en 1959 ; provoquée par une approche non consensuelle du transfert de pouvoir de la colonisation aux colonisés que nous étions. C’est le premier conflit majeur qui secoua notre pays. Un signe prématuré qui ne trompe pas sur la fragilité de nos populations à cette époque. Depuis, nous avons sûrement évolué, mais pas au point de ne plus y penser et ne pas en tenir compte : « une bagarre à côté de la gare dite petite vitesse (PV) qui eut lieu à cet endroit, fut l’étincelle qui brûla la plaine». Cette leçon initiale, l’avons- nous comprise ? – Sont arrivées les journées insurrectionnelles des 13, 14 et 15 août 1963, trois ans à peine après l’indépendance. Cet événement a eu le mérite de rompre avec la culture politique « indigèno- coloniale » d’avant l’indépendance. Il marque un tournant politique qui nous engage vers la modernité, en dépit des avatars. C’est une quasi aventure qui a eu au moins le mérite d’exister; un échec dont l’examen critique propre à le féconder n’a jamais eu lieu, alors qu’aujourd’hui encore, il s’agit d’une exigence majeure. C’est l’une des raisons qui bloque toute dynamique de progrès susceptible d’être amorcé dans le pays. Et nous ne sommes pas surpris de constater que nous ne savons pas ce que nous voulons pour ne tourner qu’en rond. – Vient le stationnement à Brazzaville des troupes soviéto- cubaines en 1975, sous la supervision du commandant Marien Ngouabi, Président de la République du Congo, engagées dans la lutte pour l’indépendance de l’Angola, à la conquête de Luanda au profit du MPLA. Cette incursion a fait de notre pays dans l’impréparation et l’innocence qu’on nous connaît une zone ((d’affrontement)) et de risque digne de la guerre froide. C’est notre existence en tant que nation qui était gravement menacée par cette odyssée sans pareil dans une Afrique en marche pour la libération nationale, c’est le mérite d’avoir pris ce risque au nom
des mouvements de libérations nationales africaines. Plus près de nous, la Conférence nationale souveraine de 1991 qui voulant rompre avec un passé devenu de plus en plus pesant sous la poussée irrésistible de la Pérestroïka soviétique, amplifiée par la déclaration de la Baule du Président Mitterrand, faillit basculer le pays dans un désordre et une anarchie à peine contenus. Les tumultes et les casses qui s’en suivirent entre 1992 et 1997 le démontrent à suffisance. Ce tragique parcours est la preuve que nous sommes encore une nation en construction. Un tel édifice s’élève patiemment et délicatement surtout à notre époque. Il s’appuie sur des symboles forts qui mettent le pays en lumière et le détachent de tout ce qui relève de l’obscurantisme sauf si l’on a aucune ambition nationale digne de ce nom.
2016 est une occasion unique à cet égard. Il faut pouvoir poser un acte puissamment symbolique cette année-là qui ferait entrer le Congo par la grande porte de l’histoire des luttes démocratiques de notre continent. Notre pays est un édifice qui est bâti sur une fondation que l’on appelle la « Constitution »;. La Constitution et le pays ne font qu’un. Nous avons tendance trop souvent à l’oublier. Par conséquent, toute approche politique y compris la thèse d’un 3e mandat ne saurait s’en départir. « Permettez-nous en conséquence de revenir sur le sens de cette thèse que nous contestons. Si nous avons bien compris, les intervenants qui l’ont construite dans l’opinion ont été animés par un élan dû à leur conviction que nous
comprenons. C’est ainsi qu’ils ont proposé au Président de la République en fonction d’accepter qu’à la fin de son mandat, en cours, de se représenter à l’élection présidentielle de 2016. Ils le lui demandent en signe de reconnaissance, parce qu’homme d’exception, bâtisseur hors pair et artisan de la paix, étant le seul dans le contexte actuel qui peut faire face aux problèmes du Congo ». C’est une prise de position qui a le mérite non seulement d’exister, mais qui était attendue de la part de tous ceux qui ont toujours cru au destin de «l’homme Sassou». Nous la respectons, mais nous nous réservons quant à la conclusion qui en découle à savoir la promotion de la candidature du futur ex-président Sassou pour un 3e mandat.
Nous sommes amenés à réagir ainsi dans l’intérêt de la consolidation de nos institutions, une préoccupation que nous sommes censés avoir en partage avec tous ceux qui représentent l’autorité de l’Etat et qui engagent l’avenir de ce pays. Et au-delà, si nous regardons autour de nous, ce genre de posture que l’on peut comprendre, n’est plus de mise. Chaque chose a son temps.
Mieux, pour nous, le débat en soi n’est pas un débat pour ou contre Sassou d’autant plus que la Constitution dit qu’il ne peut pas être candidat à la fin de son 2e mandat. A priori, on ne peut pas être contre quelqu’un qui ne peut pas être candidat. Agir ainsi relèverait de l’anticipation mal placée et ramènerait le débat à un niveau qui est personnel, militant et souvent engageant. Le
débat qui nous sollicite quant à nous est celui de déterminer si la modification des articles 57 et 185 est juridiquement fondé et politiquement opportun avec la seule ambition de voir le Congo en 2016 donner la preuve de sa maturité politique. A cette interrogation légitime, nous répondons : Pour nous, Il existe un risque réel de laisser aller le Congo dans la voie incertaine d’une révision constitutionnelle mal contenue, motivée par des considérations qui ne sont pas toujours perçues par tous comme relevant d’un intérêt général bien compris. Au-delà, ce n’est pas le seul argument dissuasif qui nous sollicite. Notre nation est en pleine édification. Nous sommes au XXIe siècle. Elle est donc tenue de vivre en harmonie avec un environnement international de plus en plus friand et exigeant d’une certaine éthique démocratique. Le respect de la constitution est partie intégrante de cette exigence. C’est dire que nous avons quelque part une sorte d’obligation morale à nous y aligner. Cela ne se dit pas, mais s’analyse et se comprend. L’observation sur le plan international également nous montre que la thèse d’un 3e mandat que l’on peut réclamer pour un candidat n’est pas compatible avec la culture politique de nos jours comme nous venons de le souligner plus haut. A ce titre, permettez-nous de citer quelques exemples illustratifs qui peuvent faire «jurisprudence du point de vue des usages et de la culture démocratique dans le monde» Nous constatons qu’en 1951 fut ratifié le 22ème amendement qui officialise la limite de deux mandats pour le président des Etats Unis. C’est le fruit d’une évolution devenue une culture, une manière d’être et qui paraît quasi intangible. En effet l’exemple des présidents américains depuis 1951 montre la religion qui est la leur, quant au respect absolu de cette disposition constitutionnelle relative au nombre de mandats. Plus près de nous, les présidents Reagan et Bill Clinton ont fait des mandats politiques couronnés de succès, le peuple américain ne
s’est jamais rué aux brancards pour réclamer leur maintien au pouvoir sous quelques prétextes que ce soit. Dans un tel modèle démocratique, ce n’est pas simplement pensable… Certains d’entre vous objecterons que le peuple congolais n’est pas le peuple américain. Soit… Mais que dire alors du cas du Ghana, du Sénégal, de la Tanzanie pour ne citer que ces pays frères qui sont comparables au nôtre à maints égards. Souvenons-nous du pays que l’on appelait «Côte de l’or» devenu le Ghana à l’indépendance. Il nous offre un exemple inédit et édifiant de fidélité à la Constitution que nous allons explicitement revoir ensemble. Un officier de l’armée de l’air nommé Rollings mit hors d’état de nuire la junte militaire corrompue et antinationale au pouvoir dans son pays. Ce fut avec une violence inouïe. Cette junte militaire, est celle qui renversa par un coup d’Etat militaire L’OSAGEFO Nkwamé Nkrumah, premier Président du Ghana indépendant chantre de l’unité africaine. Après quelques péripéties liées à leur résistance au camp Rollings, ce dernier l’emporta définitivement. Il établit la nouvelle règle du jeu qui voulait que si le président élu exerce deux mandats successifs, il cesse définitivement de postuler à cette fonction. Le Ghana s’est inscrit dès lors dans cette logique après que Rollings eut tiré sa révérence à la fin de son 2e mandat. Cet acte a été vécu par toute l’Afrique comme un acte politique majeur, vite trouva ses émules. Cette dynamique représente aujourd’hui en Afrique un des symboles de référence. On ne peut plus parler ni d’avancée démocratique, ni de démocratie tout court dans les pays d’Afrique noire sans se référer au Ghana, au Sénégal, à la Tanzanie et à d’autres pays africains qui se sont tenus jusque-là au même respect strict du nombre de mandats. Au regard de ces exemples, les partisans congolais impliqués dans une démarche de révision systématique des articles 57 et
185 de la constitution, démarche quelque peu insolite parce qu’insoupçonnée jusque-là, vont selon nous dans le sens contraire de ce qu’il faudrait faire en Afrique. Ne peuvent-ils pas au nom de la foi dans leur pays, se donner un devoir de fidélité à leur Constitution, afin de préserver la pérennité de l’article 57 qui est un gage de modernité et de renforcement de notre système démocratique encore balbutiant. Chers frères et amis. Avons-nous le droit, nous qui croyons à la démocratie de manquer le rendez-vous de 2016 qui nous ouvrirait la porte d’entrée dans la grande famille des pays démocratiques d’Afrique ? Quel intérêt avons-nous de continuer à porter cette image encombrante et indigne de «République bananière » qui nous colle à la peau. Nous savons tous que le sentiment que nous partageons en dépit de tout, nous ligue au plus profond de nos consciences contre cette image qui dégrade notre pays. Il faut faire quelque chose et toujours plus… c’est notre devoir. C’est ici que les patriotes congolais attendent beaucoup de leur président. Nous savons aussi pertinemment que l’année 2016, est pressentie par une partie importante de notre peuple comme une année de tous les dangers. Il s’est installé, en eux, comme un doute, se référant à notre passé récent et tumultueux. On ne peut atteindre notre but quels que soient nos objectifs en nous laissant prendre par des peurs, des suspicions qui ne suscitent que rancœurs et règlements de comptes qui finissent toujours à l’avantage des uns et au détriment des autres. Et très souvent le bras de fer qui en résulte entraîne destructions et désolations n ‘épargnant ni riches ni pauvres. Dans ce cas, il est plus que pertinent que l’on ne se laisse pas envahir par les peurs. Faisons appel à la raison et au bon sens en sachant que : «gouverner c’est prévoir» pour qu’ensemble nous
trouvions la bonne parade à cette tragique éventualité. Cette parade pourrait être un “Pacte national consensuel” édictant toutes les conditions nécessaires au déroulement démocratique, dans la paix et l’unité nationale de l’élection présidentielle de 2016. Elle est la rampe de lancement du prolongement positif des efforts entrepris par le pays depuis près d’une décennie. Cependant, il n’y a pas de règle sans exception. S’il y avait, à la veille de 2016, la guerre, la peste généralisée, une catastrophe naturelle d’envergure nationale, un fait extraordinaire qui ébranlerait les bases de la nation, dans ces cas et uniquement, le Président de la République assumerait la continuité de l’Etat sans autre forme de procédure constitutionnelle qu’une déclaration solennelle du Parlement réuni en congrès. Ce serait la marque de la grande union nationale derrière son chef pour une grande cause. C’est l’exception. Alors, que peut-on attendre du Président de la République ? Si la paix et l’unité nationale sont au cœur de nos préoccupations, l’élection présidentielle de 2016 doit être d’abord conçue comme un grand moment de paix et d’unité nationale pour le présent et les décennies qui suivent, la paix étant la condition sine qua non du développement qui est notre objectif majeur. En conséquence, nous sommes en droit d’attendre du Président de la République l’obligation morale et citoyenne de s’inscrire dans cette logique et de la nourrir de son expérience quelle que soit la place qui sera la sienne dans la société, par la suite. Nous l’en savons capable et nous lui en serons gré. En conséquence, tous ensemble nous devons créer les conditions pour qu’il en soit ainsi dans l’intérêt de la nation qui a besoin de prendre un nouvel élan pour sa construction.
Nous souhaitons vivement, que nos thèses respectives servent uniquement à aider le Président de la République à prendre une décision qui l’engage vers la paix et l’unité nationale. Ce qui est important pour nous, ce n’est pas l’élection présidentielle en soi qui n’est qu’un test démocratique conventionnel, qui a lieu en tout temps, dans tous les pays, à notre époque. C’est plutôt la validation, que permet ce test, de notre maturité politique et de notre capacité à respecter nos propres règles du jeu. C’est un gage de confiance à notre pays. C’est un capital à fructifier de tous nos efforts et à préserver jalousement. Nous sommes ceux qui pensent avec conviction que le président de notre pays arrive au moment où il doit servir le Congo à travers l’Afrique, à l’instar d’Abdou Diouf, de Konaré et de Rawlings pour ne citer que ceux-là. Nous savons également tous qu’en 2016, l’Afrique centrale va se transformer en un véritable théâtre électoral. L’élection présidentielle aura lieu au Tchad, au Gabon, au Congo, au Cameroun et peut-être dans d’autres pays que nous n’avons pas cités. Pouvons-nous dissocier, compte tenu du rôle que notre pays et son Président jouent en Afrique centrale, toutes ses élections ? Serait-il décent que le Congo s’empêtre dans des difficultés plus ou moins inattendues pour être plus que l’ombre de lui-même au cours de ses événements ? Ne risquons-nous pas dans l’hypothèse la plus pessimiste que nous ne souhaitons pas d’assister à un véritable imbroglio en Afrique centrale et à quel prix ? A contrario, la réussite de notre pays dans ce contexte ne peut- elle pas constituer un gage de succès de toutes les élections présidentielles de cette année en Afrique centrale ? Ce qui est notre souhait le plus patriotique. Ce ne serait pas faute de l’avoir
pressenti et l’avoir dit sachant bien que notre Afrique centrale est une zone dont la fragilité politique ne fait l’ombre d’aucun doute. Quelle image pour l’Afrique centrale et quelle responsabilité ? C’est aussi toute la question. C’est au regard de tous ces événements qu’il faut tenter d’appréhender la thèse du 3e mandat que nous venons d’évoquer. Quant au président de la République, il y a toutes les raisons d’utiliser son expérience au service d’autres grandes causes, le Congo ayant déjà pris ce qu’il a en lui de meilleur. Pour les autres citoyens et les autres dirigeants, il ne s’agit ni </M se faire plaisir ou de se laisser aller par habitude à ses t Convictions, ni de faire plaisir à un homme qui n’en demande peut-être pas autant. Il s’agit du pays, de la nation et de la Constitution, notre loi suprême.
Maître Mberi Martin
 La RDC s’inquiète de la résurgence d’une vieille rébellion ougandaise dénommée ADF-Nalu (Forces démocratiques alliées – Armée de libération de l’Ouganda), soupçonnée de bénéficier du soutien des islamistes Shebab somaliens. Une menace de plus avec celle du Mouvement du 23-Mars (M23) qui combat l’armée congolaise dans l’est du pays.
La RDC s’inquiète de la résurgence d’une vieille rébellion ougandaise dénommée ADF-Nalu (Forces démocratiques alliées – Armée de libération de l’Ouganda), soupçonnée de bénéficier du soutien des islamistes Shebab somaliens. Une menace de plus avec celle du Mouvement du 23-Mars (M23) qui combat l’armée congolaise dans l’est du pays.