 -Les associations de lutte contre le cancer du col de l’utérus sont descendues dans la rue, le samedi 27 septembre sur le site de l’Université de Kinshasa. But : mobiliser la communauté nationale contre les menaces que représente le cancer de l’utérus identifié comme 1ère cause de décès de la femme en RDC.
-Les associations de lutte contre le cancer du col de l’utérus sont descendues dans la rue, le samedi 27 septembre sur le site de l’Université de Kinshasa. But : mobiliser la communauté nationale contre les menaces que représente le cancer de l’utérus identifié comme 1ère cause de décès de la femme en RDC.
Le cancer de col utérin est identifié comme étant la première cause de mortalité de la femme en République démocratique du Congo. Après lui vient le cancer du sein. Dans le monde, le cancer de l’utérus est responsable de 250 mille décès par an, dont 80% se retrouvent dans les pays en développement.
En l’absence d’intervention rapide, la mortalité associée au cancer du col pourrait augmenter de 25% au cours de dix prochaines années. Ces informations ont été données par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à la faveur de la première marche de sensibilisation et de plaidoyer contre le cancer de col utérin organisée par l’Organisation africaine pour la recherche et l’enseignement sur le cancer (OAREC/AORTIC) et Globe Athon.
Avec l’appui financier de l’OMS, la marche a été organisée, le samedi 27 septembre sur le site de l’Université de Kinshasa (Unikin). Cette marche silencieuse qui a mobilisé toutes les forces vives de l’Unikin s’est étalée sur une boucle de 2,7 km, depuis le bâtiment administratif de l’Unikin, en passant par les facultés de Sciences (Biologie, Mathématique, Sciences de la terre), Médecine; un détour par la morgue ; l’Institut technique médical du Mont Amba; les Cliniques universitaires de Kinshasa (CUK), les facultés des sciences agronomiques, de Psychologie; l’entrée principale (Trafic) et l’arrivée a été constatée devant le bâtiment administratif.
Mais avant de se lancer dans la marche, la partie protocolaire, dans la salle des promotions Mgr Luc Gillon de l’Unikin, a été ponctuée d’allocutions.
Le recteur de l’Unikin, Jean-Berckmans Labana, a indiqué, d’entrée de jeu, que la marche volontariste pour « combattre le cancer de l’utérus a la particularité de mobiliser non seulement les forces vives de l’Alma Mater, mais également des hôtes de marque parmi lesquels les invités de la République du Congo (Brazzaville), les représentants du directeur de l’OMS/RDC, du ministre intérimaire de l’Enseignement supérieur, universitaire et de la recherche scientifique (ESURS), etc. »
A sa suite, M. Casimir Manzengo, délégué de Dr Joseph Cabore, représentant de l’OMS RDC, a fait savoir que cette marche est organisée chaque année dans le monde grâce à Globe Athon dans le but de vulgariser l’information, encourager ainsi la prévention et promouvoir la détection précoce comme meilleur moyen de lutte préventive contre le cancer du col de l’utérus.
Pour l’OMS, a-t-il ajouté, la lutte contre le cancer du col utérin est une grande priorité de santé publique. En 2005, la Résolution 5822 de l’Assemblée mondiale de la santé sur la prévention et la lutte contre le cancer a, une fois encore, rappelé l’importance de l’enjeu que constitue le cancer, en soulignant que seule une action élargie et intégrée pourra stopper cette épidémie mondiale. Et puis, en tant que maladie non transmissible, le cancer du col a fait partie de la deuxième grande résolution des Nations unies en matière de santé, après la première consacrée au Vih/Sida en 2001.
Instaurer la vaccination contre le HPV
Le cancer du col peut être évité grâce au dépistage précoce et au vaccin. Raison pour laquelle l’OMS préconise qu’on agisse vite en rendant l’accès aux services de prévention abordable et efficace.
D’autre part, il faut préconiser une action de vaccination de toutes les femmes pour les protéger contre l’infection au virus de papillon humain (HPV). En fait, depuis 2006, un vaccin protégeant contre l’infection et la maladie associée au HPV a reçu l’autorisation de mise sur le marché. L’OMS estime que de nouveaux vaccins contre le HPV dans le mode en développement pourraient sauver des centaines de milliers de vies humaines s’ils sont administrés de manière efficace.
Le professeur Charles Gombe du Congo/Brazzaville a partagé l’expérience de son pays sur une campagne de vaccination de la jeune fille menée dans la région de la Lekoumou et des études menées dans l’optique de vacciner des jeunes gens.
Les associations de lutte contre le cancer, par la bouche du professeur Léon Mbala Nlandu, vice-président de la Ligue nationale contre le cancer (LINAC), a dénoncé l’inaction de toute la communauté nationale qui se montre complice du HPV, agent causal du cancer du col utérin. Il a, par la suite, invité tout le monde à couper le lien avec le HPV, à instaurer la vaccination de la femme contre le cancer et le dépistage précoce des cancers de l’utérus et du sein.
Le professeur Jean-Marie Kabongo Mpolesha, président élu de l’Organisation africaine pour la recherche sur le cancer (OAREC/ AORTIC), a présenté son ONG basée en Afrique et créée en 1983 par des expatriés africains prestataires des soins oncologiques, des scientifiques et leurs amis. L’OAREC se consacre à la promotion de la lutte contre le cancer, au dépistage, au traitement et aux soins palliatifs en Afrique.

 -Plus de 80% des personnes atteintes du sida en République démocratique du Congo n’ont pas accès à un traitement et cette situation est “inacceptable”, a dénoncé vendredi Médecins sans frontières (MSF).
-Plus de 80% des personnes atteintes du sida en République démocratique du Congo n’ont pas accès à un traitement et cette situation est “inacceptable”, a dénoncé vendredi Médecins sans frontières (MSF).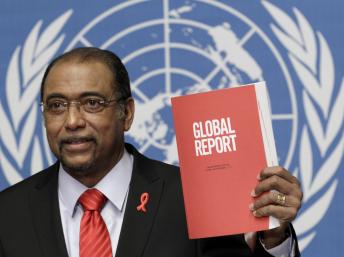




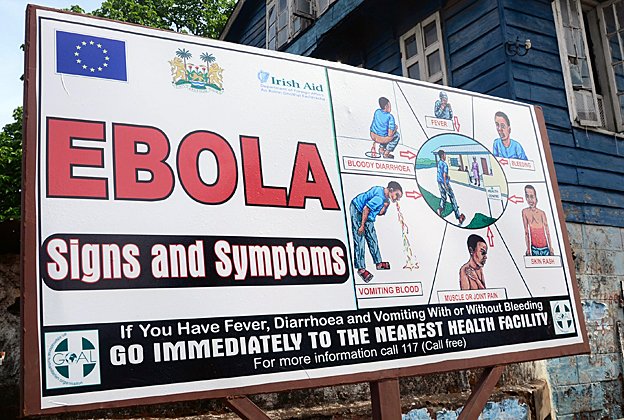








 Depuis plusieurs années en France, McDonald’s travaille sur le profil nutritionnel et la diversification de son offre pour proposer à ses clients des produits adaptés à leurs attentes et besoins. Comment savoir si cette politique nutritionnelle a un impact sur la consommation des clients dans les restaurants ?
Depuis plusieurs années en France, McDonald’s travaille sur le profil nutritionnel et la diversification de son offre pour proposer à ses clients des produits adaptés à leurs attentes et besoins. Comment savoir si cette politique nutritionnelle a un impact sur la consommation des clients dans les restaurants ?



