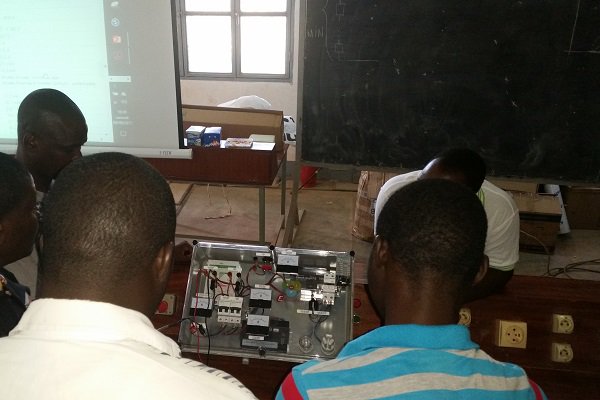Alors que la RDC attend l’annonce par la Ceni des premiers résultats des élections générales du 30 décembre, Jean-Jacques Lumumba, le petit-neveu de Patrice Lumumba, appelle à un sursaut patriotique de l’opposition politique congolaise.
En ce moment précieux pour l’alternance démocratique, je tiens à remercier le peuple congolais qui a prouvé à suffisance qu’il était en quête d’une alternance pacifique et démocratique pour mettre fin à ce régime avilissant qui a plongé le pays dans une gestion chaotique et catastrophique, remmenant la RDC au 184e rang sur 190 au dernier classement Doing Business de la Banque mondiale, ce qui amenuise tous les espoirs d’investissements sérieux en l’état actuel des choses.
>>> À LIRE – Élections en RDC : une journée de vote historique marquée par des couacs et la détermination des Congolais
Nous avons assisté depuis l’échec de Genève à une montée en puissance de l’intolérance et des insultes venant de tous les camps de l’opposition, ce qui a suscité dans le chef de beaucoup de Congolais un sentiment de regret et de déception profonde quant aux différentes perspectives de changement que propose cette opposition, qui du reste regorge de quelques fils du pays passionnés et amoureux de l’avenir du pays.
Chers opposants, ne commettez pas une erreur de plus sur ce que vous avez déjà commis jusqu’ici
Une victoire proche
Néanmoins, des différentes sources crédibles sur le terrain et même au sein de certains patriotes au sein de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni), malgré le régime répressif de Monsieur Kabila, nous avons reçu des informations concordantes sur la victoire écrasante de l’opposition politique à travers ses deux candidats majeurs, très loin devant le dauphin du FCC.
Par cette expression populaire de rejet au régime avilissant de Monsieur Kabila, le peuple congolais a démontré son attachement aux valeurs démocratiques et d’alternance pacifique, malgré les élections chaotiques organisées par la Ceni sous l’impulsion du gouvernement congolais, afin de plonger la nation toute entière dans une crise post-électorale sans précédent.
Le peuple nous a prouvé à tous qu’il veut la rupture avec la gouvernance de corruption, de prédation et de destruction contre laquelle nous sommes tous en train de payer de nos vies
C’est ainsi que je lance en ce jour un message et un vibrant appel de sursaut patriotique aux deux plateformes de l’opposition congolaise. Chers opposants, ne commettez pas une erreur de plus sur ce que vous avez déjà commis jusqu’ici car le peuple nous a prouvé à tous qu’il veut la rupture avec la gouvernance de corruption, de prédation et de destruction contre laquelle nous sommes tous en train de payer de nos vies.
Appel à la neutralité
À la communauté sous-régionale et à l’Union africaine (UA), je rappelle votre rôle de neutralité et d’assistance au peuple congolais qui attend des résultats dignes de foi conformes à la vérité des urnes et à la justice. Vos accointances avec un camp politique auront des incidences majeures sur la sous-région car rien ne saura arrêter cet élan de transformation de la nation congolaise.
Aux Nations unies et plus particulièrement à la Monusco, je rappelle sa mission de protection et de sécurisation de la population congolaise.
À la communauté internationale, j’en appelle au durcissement des sanctions contre tous les ennemis du peuple congolais trempés dans la corruption, les violations des droits de l’homme et le sabotage du processus électoral, tout en saluant la position courageuse du gouvernement américain face à la mascarade électorale et au durcissement du régime finissant de Monsieur Kabila.
À la Ceni, je rappelle la neutralité même si nous savons tous le niveau d’inféodation de cet organe qui se dit indépendante par le pouvoir sortant.
J’encourage Monsieur Kabila à quitter pacifiquement le pouvoir en reconnaissant son échec par le rejet de son dauphin
À Monsieur Kabila, que j’encourage à quitter pacifiquement le pouvoir en reconnaissant son échec par le rejet de son dauphin, j’en appelle à penser à sa famille et à tous ceux qu’il aime car son nom risque d’entrer dans les oubliettes de notre triste histoire.
Au peuple congolais que je félicite, je vous dis que notre victoire est plus proche que nous ne pouvons l’imaginer et elle est à notre portée. Les autres n’interviendront que si nous nous levons pour arracher notre liberté.
Que dieu bénisse la République démocratique du Congo.
![[Tribune] RDC : opposants, ne gâchez pas cette occasion historique](https://lavdc.net/wp-content/uploads/2019/01/31369/tribune-rdc-opposants-ne-gachez-pas-cette-occasion-historique.png)