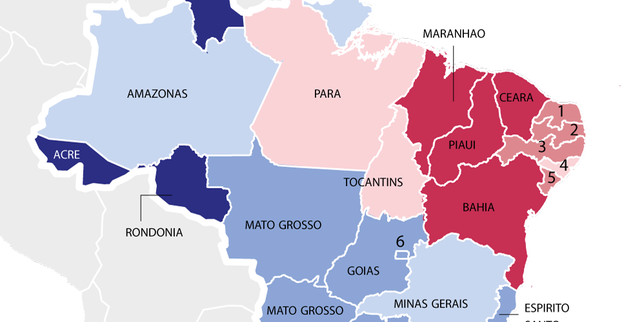Angela Merkel, 64 ans, dont treize au pouvoir en Allemagne, a longtemps paru indétrônable. Mais des crises à répétition au sein de sa coalition et les critiques contre sa politique migratoire ont fini par fragiliser irrémédiablement la chancelière allemande.
Elle en a tiré de premières conséquences, lundi 29 octobre, au lendemain d’un énième revers électoral dans la région de Hesse, en annonçant qu’elle quitterait la tête de l’Etat à l’issue de son mandat de chancelière, en 2021, et qu’elle se retirerait de la vie politique.
Quelques heures plus tôt, la plus ancienne dirigeante européenne en exercice avait annoncé à ses troupes qu’elle quitterait en décembre la présidence du parti conservateur, l’Union chrétienne-démocrate d’Allemagne (CDU). Un premier pas vers la fin de sa carrière politique. Retour sur les trois années qui ont isolé politiquement la chancelière allemande.
-
Automne 2015 : Merkel accueille près de 900 000 demandeurs d’asile
C’est à l’automne 2015 que tout a basculé. A la tête de l’Allemagne depuis dix ans, Angela Merkel décide d’ouvrir son pays à 890 000 demandeurs d’asile fuyant la guerre en Syrie ou la pauvreté. Malgré les inquiétudes de l’opinion, elle promet de les intégrer et de les protéger. « Wir schaffen das » (nous y arriverons), assure-t-elle au plus fort de la crise des réfugiés.
Lire l’analyse : Angela Merkel a du mal à faire oublier son « Wir schaffen das »
Cette décision historique, prise sans avoir véritablement consulté ses partenaires européens, divise autant au sein de l’Union européenne que les Allemands eux-mêmes. Fin 2015, celle qui fut un temps dépeinte en nazie en Grèce pour son inflexibilité financière face à Athènes, est ironiquement surnommée « Mère Angela », en référence à mère Teresa, par le magazine Der Spiegel.
-
Septembre 2016 : battue dans sa circonscription par l’extrême droite
Sa politique d’ouverture lui vaut d’être qualifiée « chancelière du monde libre » par le Time en décembre 2015. Un an plus tard, après le séisme Donald Trump, Angela Merkel apparaît à certains observateurs comme un antidote à la montée des populismes. Mais la crise migratoire inquiète, la peur de l’islamisme et des attentats djihadistes s’installent, et l’électorat conservateur allemand se détourne en partie vers l’extrême droite.
Le 4 septembre 2016, lors d’élections régionales du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, le parti anti-immigration Alternative pour l’Allemagne (AfD) devance la CDU de la chancelière allemande dans son fief électoral. La claque est brutale pour Mme Merkel. Cette année-là, l’Allemagne accueillera 280 000 demandeurs d’asile.
Lire aussi : Claque électorale pour Angela Merkel dans sa région
-
Septembre 2017 : l’AfD fait son entrée au Bundestag
Le 24 septembre 2017, c’est un tabou de l’après-guerre qui tombe. Avec 94 élus, la formation d’extrême droite fait une entrée historique au Parlement à la faveur des élections législatives.
La percée de l’AfD a été permise par l’effondrement des deux grands partis traditionnels. La CDU (conservateurs) et le SPD (sociaux-démocrates) ne totalisent à eux deux que 399 sièges au Bundestag, soit 56 % du Parlement. Il faut remonter à 1949, où ils ne détenaient que 67 % des sièges (avec 277 députés sur 410), pour retrouver un score aussi faible.
En 2017, le nombre de demandeurs d’asile en Allemagne est passé à 180 000, soit 100 000 de moins qu’en 2016. Mais Angela Merkel continue de voir une partie de ses électeurs se tourner vers des formations hostiles à sa politique d’immigration, l’extrême droite et les Libéraux du FDP.
Notre décryptage : Ce qu’il faut retenir de l’entrée de l’extrême droite au Parlement allemand
-
Mars 2018 : une coalition créée dans la douleur, et qui reste fragile
C’est dans la douleur qu’Angela Merkel parvient finalement à entamer un quatrième mandat de chancelière, en mars 2018… près de six mois après les élections législatives. Après d’interminables tractations pour former un gouvernement de « grande coalition », elle trouve un accord entre son camp conservateur (CDU-CSU) et les sociaux-démocrates du SPD.
Mais la recette du compromis permanent concoctée sous l’égide de la chancelière a fini par lasser les électeurs dans un monde politique allemand atomisé et électrisé par l’irruption du discours antimigrant porté par l’extrême droite . En conflit répété sur la politique d’asile avec son ministre de l’intérieur et patron de la droite bavaroise, Horst Seehofer, Mme Merkel voit son étoile pâlir.
A deux reprises déjà, la « Grosse Koalition » CDU-CSU-SPD a failli éclater en raison de divergences sur l’immigration et la proximité présumée de l’ex-chef des services de renseignement Hans-Georg Maassen avec l’extrême droite.
Lire aussi : Horst Seehofer, ennemi de l’intérieur pour Angela Merkel
La chancelière lutte aujourd’hui pour le maintien de sa coalition avec le Parti social-démocrate, mais celle-ci apparaît au bord de l’implosion à la suite des échecs électoraux des deux partis en Hesse et en Bavière. Un départ du SPD de la coalition signerait la fin du gouvernement actuel et probablement celle de la carrière politique d’Angela Merkel.