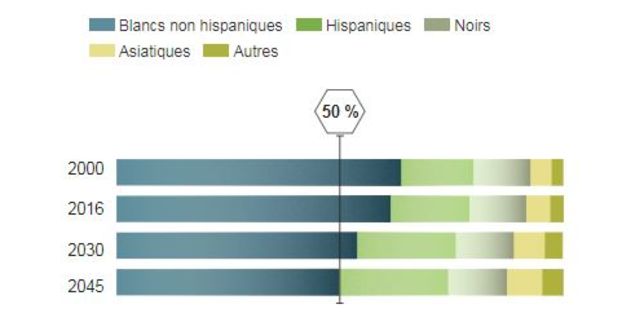Il y a eu Donald Trump et Rodrigo Duterte en 2016, l’Autrichien Sebastian Kurz et son allié du FPÖ Heinz-Christian Strache en 2017, enfin le duo italien Matteo Salvini-Luigi Di Maio et le Brésilien Jair Bolsonaro en 2018. Tous sont qualifiés de populistes, à la fois par leurs adversaires et par la presse – et parfois revendiquent eux-mêmes le qualificatif. De quoi parle-t-on ? Le « populisme » est qualifié d’« attitude politique consistant à se réclamer du peuple », selon la définition du dictionnaire Larousse.
Tous ces dirigeants sont arrivés au pouvoir en remportant une élection à l’issue d’une campagne où ils ont opposé le peuple contre les élites politiques ou économiques. Pourtant, ces traits communs masquent d’énormes disparités entre leurs idéologies. « Le mot “populisme” mis à toutes les sauces perd toute signification et empêche tout diagnostic pertinent », disait à juste titre le sociologue Edgar Morin en avril 2013.
Lire aussi : Du bon usage du mot « populiste » dans « Le Monde »
On trouvera par exemple des interventionnistes libéraux, des climatosceptiques religieux, des xénophobes adeptes du libre-échange et de l’interventionnisme économique ou même un ancien militaire antisystème soutenu à la fois par les églises, les milieux économiques et l’armée. Et pourtant, ces personnalités politiques font bien œuvre de populisme, « c’est-à-dire suscitent et activent les passions les plus négatives, et même les plus perverses pour étendre leur audience et entretenir leurs troupes », écrit le philosophe et professeur à l’université Paris Descartes Yves Charles Zarka. L’auteur décrit la liste des éléments que l’on retrouve dans tous ces discours, pour que « la justice, la prospérité et le bonheur soient restaurés » :
- la fabrication de boucs émissaires ;
- des « promesses d’autant plus exorbitantes que les moyens élaborés pour les satisfaire sont indigents » ;
- la désignation d’un « ennemi à attaquer ou à détruire ».
Des points communs qui ne définissent en rien la politique qu’ils mènent ou comptent mener. Pour y voir plus clair, dans l’infographie suivante, nous avons sélectionné huit thèmes politiques majeurs et nous avons tenté de les placer sur un axe les uns par rapport aux autres :
- l’exercice du pouvoir : concentré ou partagé avec les autres institutions ;
- l’environnement : plus ou moins d’écologie ;
- les sujets de société liés à la famille ou aux minorités : conservatisme ou libéralisme ;
- l’économie : de libéral comme Bolsonaro à interventionniste comme Orban ;
- la protection sociale : avec plus ou moins d’aides ;
- l’immigration : favorable ou défavorable à l’accueil ;
- le rôle de la religion dans la définition de la politique : important chez Erdogan ou faible chez Duterte ;
- le commerce international : de protectionniste à favorable au libre-échange.
” tableau += “
” tableau += “
” }); $(“#reglettes”).append(tableau); function petitRemplacement(txt) { if (largeur < 500) { return txt.toLowerCase().replace("moins", "–").replace("plus", "+").replace("à l'accueil", "") } else { return txt } }; function position(n) { m = n + 4 o = ((m / 8) * 98) return o }; function nettoyage(net) { return net.replace(/«/g, "«”).replace(/»/g, “»”).replace(/« /g, “« “).replace(/ »/g, ” »”).replace(/ %/g, ” %”) }; $(“#populisme span.bubulle, #populisme .legende .oui”) .on(“mouseover”, function() { var diri = $(this).data(“dirigeant”); $(“span.bubulle.” + diri).addClass(“mongros”) $(“span.bubulle:not(.” + diri + “)”).css(“opacity”, .2) }) .on(“mouseout”, function() { $(“span.bubulle”).css(“opacity”, 1).removeClass(“mongros”) }); /* La gestion du tooltip, ici sur la span.bubulle */ $(“#populisme”).tooltip({ show: { effect: “fade”, duration: 0 }, hide: { effect: “fade”, duration: 0 }, items: “span.bubulle”, track: true, tooltipClass: “multimedia-embed tooltipdecodeurs”, position: { my: ‘left+60 center’, at: ‘right+10 center’ }, content: function() { return $(this).data(“tt”) }, open: function(event, ui) { /* permet de fermer le tooltip en tapant sur lui-même en mobile*/ var $element = $(event.target); ui.tooltip.click(function() { $element.tooltip(‘close’); }); } }); $(“#populisme a”).click(function(event) { event.stopImmediatePropagation() }); });