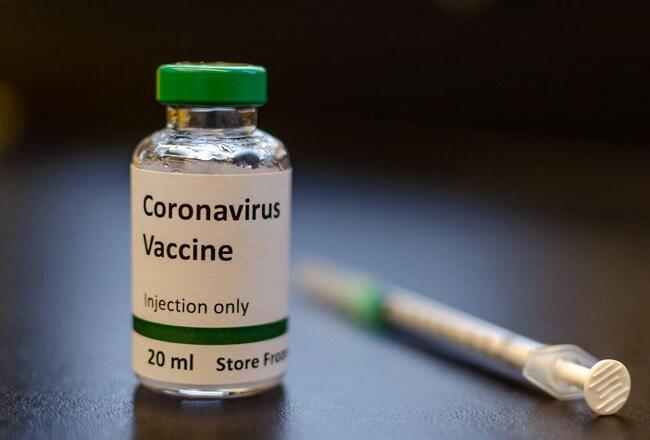C’est en mettant la main au portefeuille que le footballeur sénégalais de Liverpool Sadio Mané a marqué son soutien. L’attaquant vedette a fait don de 30 millions de francs CFA (environ 45.000 euros) à la lutte contre le Covid-19 dans son pays, selon son manager cité dans les médias.
En Côte d’Ivoire, le retraité du ballon rond Didier Drogba a donné des masques à la cathédrale d’Abidjan, avec cette mise en garde: « Mes soeurs, mes frères, je vous demande de prendre le sujet très au sérieux, car nous avons tendance à être trop légers quant à nos réactions face à la situation ».
« Mes frères, mes soeurs, mes chers parents, je vous demande de respecter les consignes données par les autorités de nos pays et l’organisation mondiale de la santé. Faisons-le, par Amour. Je vous aime », a lancé un autre retraité célèbre du ballon rond, le Camerounais Samuel Eto’o.
Touchée après l’Asie et l’Europe, l’Afrique subsaharienne ne comptait que 1.642 cas pour une vingtaine de décès, selon un comptage de l’AFP jeudi à 11h00 GMT à partir des cas officiellement déclarés.
Le continent redoute une propagation qui mettrait à rude épreuve ses fragiles structures sanitaires.
En Afrique du Sud, pays le plus touché du continent en nombre de cas (927 cas confirmés jeudi), le capitaine des Springboks, champions du monde de rugby, Siya Kolisi, soutient le confinement décrété par le président Cyril Ramaphosa dans une vidéo désopilante, assis sur les toilettes en train de lire en surveillant d’un oeil ses deux enfants dans la baignoire. Le confinement doit commencer vendredi.
– Union sacrée –
Les musiciens ne sont pas en reste. A Dakar, Youssou N’Dour, chanteur et fondateur du Groupe Futurs Médias (presse écrite, radio, télévision), a remis mi-mars un lot de matériel et d’équipements sanitaires au ministère de la Santé.
Les artistes jouent l’union sacrée autour des messages de prévention des autorités, même les voix les plus frondeuses en temps ordinaire.
En Ouganda, le chanteur Bobi Wine, député une nouvelle fois arrêté début janvier pour son opposition au président Yoweri Museveni, lance à ses fans « observez la distanciation sociale et la quarantaine », dans une vidéo sur Twitter.
Au Sénégal, le collectif de rappeurs « Y en a marre », habituellement engagé contre la corruption et pour le renouvellement du personnel politique, a sorti une chanson et un clip, « Fagaru Ci Corona » (« prévenir le corona en wolof »).
En République démocratique du Congo, les stars de la rumba chantent pour une fois autre chose que l’amour, ses joies et ses tourments. « Fally en mode confinement, les bisous stop », a lancé sur Twitter Fally Ipupa dans une mélodie improvisée sur une guitare acoustique.
« Alors s’il vous plaît mes chers frères et soeurs, respectons le confinement, c’est très très important, restez à la maison, respectez les consignes données par les autorités et l’OMS », ajoute le crooner de Kinshasa.
Les autorités de son pays ne sont pas allées jusqu’au confinement, décrétant la fermeture des frontières, des lieux publics, et l’isolement de Kinshasa.
Voix grave et ton de circonstance, son compatriote Koffi Olomide a mis en garde les Congolais contre le « Kuluna-virus », habile remixage du terme « kuluna » qui désigne des gangs armés de Kinshasa, l’une des légendes et terreurs urbaines de la capitale aux dix millions d’habitants.
En Côte d’Ivoire, le chanteur DJ Kerozen, star du coupé décalé , y est aussi allé de sa chanson sur les réseaux: « ‘Y a corona, respectons les consignes d’hygiène , l’affaire est sérieuse oh. (…) Même Mbengué (France en argot) là-bas c’est gâté, Seigneur faut +sciencer+ nous on veut vivre! ».
Star panafricaine et référence pour des générations de musiciens, le saxophoniste camerounais Manu Dibango est décédé en France des suites du coronavirus.
Le compositeur de « Soul Makossa » est la première célébrité mondiale à succomber au virus. Le chanteur congolais Aurlus Mabélé, une figure du soukouss –version moderne de la rumba congolaise-, infecté par le coronavirus, est aussi décédé il y a une semaine à Paris.
 -Les premiers résultats préliminaires de l’étude à propos de l’utilisation de la chloroquine au Senegal pour traiter les patients atteints par le coronavirus sont désormais connus. La molécule a été prescrite à certains malades de l’hôpital de Fann à Dakar par le professeur Moussa Seydi. D’après un échantillon de 181 patients, l’hydroxychloroquine permettrait une guérison plus rapide selon le results de cet etude.
-Les premiers résultats préliminaires de l’étude à propos de l’utilisation de la chloroquine au Senegal pour traiter les patients atteints par le coronavirus sont désormais connus. La molécule a été prescrite à certains malades de l’hôpital de Fann à Dakar par le professeur Moussa Seydi. D’après un échantillon de 181 patients, l’hydroxychloroquine permettrait une guérison plus rapide selon le results de cet etude.