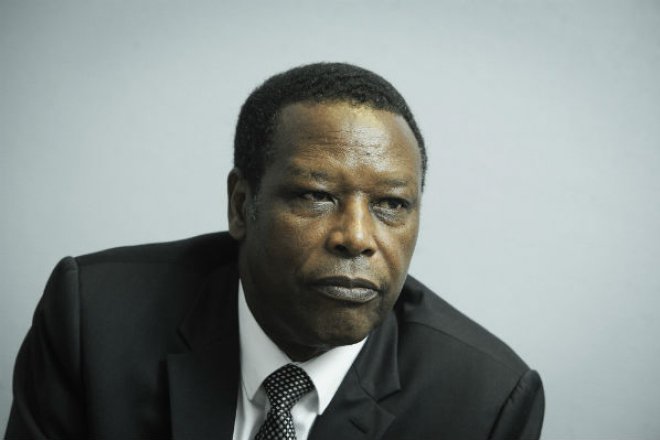-Des soldats du Soudan du Sud, du Rwanda et du Burundi font des incursions récurrentes dans les régions instables de l’est et du nord-est de la République démocratique du Congo (RDC), ont affirmé vendredi des sources locales et un groupe d’experts. Depuis avril, « nous venons d’enregistrer huit incursions de militaires sud-soudanais » dans le territoire d’Aru, dans la province de l’Ituri (nord-est), a déclaré un responsable de la société civile locale, Innocent Magudhe, à l’AFP.
La dernière incursion a eu lieu mercredi dans la chefferie de Kakwa, située à la frontière avec le Soudan du Soudan, dans la province de l’Ituri, a-t-il précisé.
Les soldats de l’armée régulière sud-soudanaise « brûlent des maisons, pillent les biens de la population (vaches, motos…) » dans une zone où les militaires congolais ne sont présents qu’en nombre réduit, selon lui.
Plus au sud, dans la région voisine des deux Kivu, la présence des armées rwandaise et burundaise « a été constatée » au courant du mois d’avril, a écrit le Baromètre sécuritaire du Kivu (KST) dans son rapport mensuel publié vendredi.
Dans le Nord-Kivu, l’armée rwandaise « a participé à la traque des rebelles hutu rwandais des Forces démocratiques pour la Libération du Rwanda (FDLR-Foca), conjointement avec l’armée congolaise ».
L’armée du Burundi est quant à elle intervenue au Sud-Kivu, « pour traquer les rébellions burundaises, notamment la Résistance pour un État de droit (RED-Tabara) avec l’appui d’autres groupes locaux », selon le KST.
« Il semble que l’objectif était de se prémunir contre les rébellions burundaises présentes au Sud-Kivu, notamment avant la présidentielle du 20 mai », au Burundi.
Le KST affirme s’appuyer sur « un réseau de chercheurs » et vérifier ces informations « avec de multiples sources fiables ».
Les rumeurs persistantes d’incursions de militaires rwandais sur le sol congolais n’ont jamais été confirmées par les autorités de Kinshasa.
Fin avril, le président rwandais Paul Kagame les avait démenties lors d’une conférence de presse à Kigali.
Le rapport du KST fait aussi état de « 85 meurtres de civils par des acteurs armés » en avril, dans les Kivu.