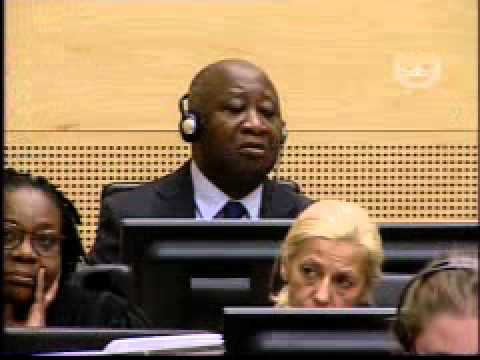-Ses relations avec les femmes, son expérience de la justice américaine, la théorie du complot… Dans une interview accordée à CNN et diffusée le 10 juillet, Dominique Strauss-Kahn (DSK) est revenu sur l’affaire du Sofitel et des accusations de viol portées contre lui par Nafissatou Diallo.
Dominique Strauss-Kahn a accordé sa première interview en anglais depuis l’affaire du Sofitel en mai 2011. Diffusé par la chaîne américaine CNN, le 10 juillet, l’entretien enregistré à Paris a été l’occasion pour l’ancien directeur du FMI de délivrer sa vérité dans l’affaire des accusations de viol proférées par une femme de chambre guinéenne de l’hôtel Sofitel de New York, Nafissatou Diallo.
Il est en particulier revenu sur le moment « terrible », où il a été présenté, menotté, devant les caméras, le 15 mai 2011 à New-York – un épisode classique de la vie judiciaire américaine, connu sous le nom de « perp walk ». « J’étais en colère, je ne comprenais pas ce qui se passait, je ne comprenais pas pourquoi j’étais là. Je comprenais juste qu’il se passait quelque chose que je ne comprenais pas », dit-il. « C’est une chose terrible, vraiment. Le problème c’est que cela se passe à un moment où, dans la société américaine comme dans la société européenne, vous êtes présumé innocent jusqu’à ce que vous soyez reconnu coupable », ajoute-t-il.
DSK a vu les poursuites pénales contre lui abandonnées par le parquet de New York, qui avait remis en cause la crédibilité de la femme de chambre. Et un accord financier confidentiel, conclu en décembre dernier avec son accusatrice, a réglé l’affaire au civil. « J’étais prêt à aller au procès (civil) », assure-t-il, ajoutant que ses avocats lui ont conseillé de ne pas le faire. « Mes avocats m’ont dit : “ça va prendre quatre ans et ça va vous coûter plus cher en frais de justice (…) même si vous gagnez”. J’ai donc décidé de (conclure) un accord financier et de continuer ma vie », déclare-t-il.
DSK : “Quelque chose est arrivé qui relevait de la vie privé”
Alors que s’est-il passé dans la chambre de cette fameuse suite 2806 du Sofitel, ce 14 mai 2011 ? « Quelque chose est arrivé qui relevait de la vie privée et je pense toujours que ce qui s’est passé dans cette chambre d’hôtel relève de la vie privée, à moins qu’un procureur vous dise que vous allez être inculpé pour avoir fait quelque chose et qu’il en ait les preuves », explique DSK. « Mais quand le procureur vous dit “OK, finalement, nous n’avons pas de quoi vous inculper”, cela veut dire que c’est une affaire privée, et personne n’a rien à dire là-dessus », poursuit-il.
Dominique Strauss-Kahn revient aussi sur la réputation d’addiction au sexe qu’il traîne depuis qu’il a été impliqué dans plusieurs affaires de mœurs – sans pour l’instant avoir jamais été condamné. Il a affirmé n’avoir « pas de problème particulier avec les femmes ». Mais il ajoute qu’il a, en revanche, « certainement un problème pour n’avoir pas compris que ce que l’on attend d’un homme politique de très haut niveau est différent de ce que peut faire M. Tout-le-Monde ».
Vie privée, vie publique
« J’ai fait cette erreur » de penser qu’on pouvait avoir vie publique et vie privée « ensemble, sans lien entre elles », ajoute DSK. « J’ai eu tort, parce que les gens n’attendent pas ce genre de comportement hétérodoxe de la part de quelqu’un qui a des responsabilités publiques. (…) Je ne voulais pas payer ce prix et finalement, je l’ai payé deux fois », ajoute l’ancien présidentiable socialiste, qui a dû renoncer à se présenter au scrutin de 2012, précisant que « désormais, les problèmes de la politique française sont derrière moi. (…) Je travaille de par le monde avec les gouvernements, je suis content d’aider et j’aime cela ».
Enfin, DSK évoque brièvement la question du complot qui aurait été mené contre lui par ses opposants politiques. Interrogé sur le sujet, il affirme qu’il y accorde quelque « crédit » mais n’en a « pas la preuve ». « Il vaut mieux donc que je ne dise rien ».
(Avec AFP)