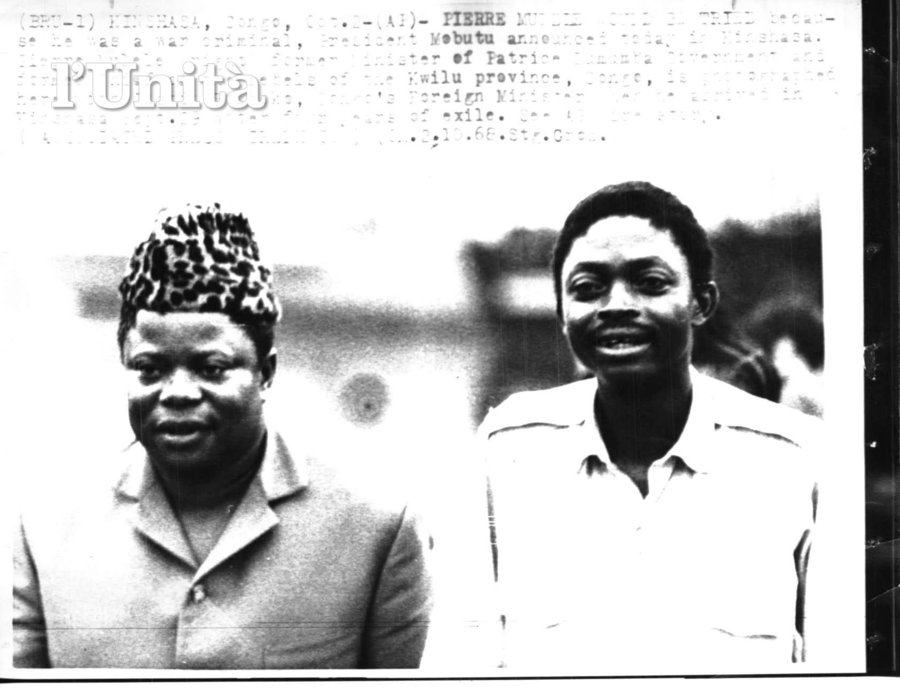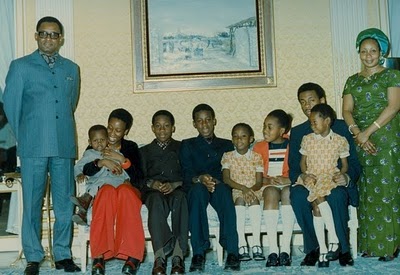-Une répression impitoyable et barbare s’abattit sur les Treize Parlementaires et sur tous les Compatriotes qui adhérèrent ouvertement et publiquement à leur Cause ou qui furent tout simplement soupçonnés de communier à leur Combat
-Une répression impitoyable et barbare s’abattit sur les Treize Parlementaires et sur tous les Compatriotes qui adhérèrent ouvertement et publiquement à leur Cause ou qui furent tout simplement soupçonnés de communier à leur Combat
- 1. Internement à la Cité de l’OUA à Kinshasa
La Gestapo du régime était déjà depuis quelque mois aux trousses des Treize Parlementaires et surveillait leurs déplacements, leurs rencontres et leurs échanges.
Le 30 Décembre 1980, M. Joseph NGALULA fut arrêté par la Gestapo du régime avec une brutalité sauvage et interné à la Cité de l’OUA à Kinshasa. Une perquisition minutieuse fut faite dans toute sa Résidence, tous les stencils de la Lettre Ouverte, les exemplaires déjà imprimés et tous les autres documents trouvés dans sa Résidence furent saisis et emmenés.
Le 31 Décembre 1980, les cinq auteurs co- signataires de la Lettre Ouverte sont allés d’eux-mêmes, courageusement, par solidarité et en cohérence avec leurs valeurs et leurs idéaux se constituer prisonniers à la Résidence même du tyran : TSHISEKEDI, LUSANGA, MAKANDA, KAPITA ET KANANA.
L’un des Chantres du Mobutisme – le tristement célèbre journaliste Mavungu Malanda Ma Mongo – cria haro sur les baudets et annonça à la Télévision Zaïroise que les « Auteurs d’un Document séditieux contre le Président-Fondateur, contre la Sûreté de l’Etat, contre la Nation et contre les 25 millions des Citoyens Zaïrois » avaient failli à leur fonction des Commissaires du Peuple, trahi la Nation toute entière et avaient même poussé la trahison trop loin jusqu’à oser violer la Zone Verte du Président-Fondateur et se constituer prisonnier.
- 2. La levée de l’immunité parlementaire
Le 2 Janvier 1981, le Conseil Législatif fut saisi d’une demande de levée de l’immunité parlementaire par un message personnel du tyran.
Devant les menaces et les intimidations de toutes sortes et devant une assistance plus nombreuse que de coutume, le Président du Conseil Législatif se vit obligé de bousculer l’ordre du jour et de refuser toute motion d’ordre et lit avec une voix tremblante le message personnel du Président –Fondateur du Parti-Etat MPR ainsi libellé :
Je tiens à porter à votre connaissance que des faits extrêmement graves viennent d’être relevés par les services de sécurité à charge de Treize Commissaires du Peuple, signataire d’un document à caractère subversif, destiné sans aucun doute à une large diffusion au public.
Ainsi, l’un des signataires, le Commissaire du Peuple NGALULA PANDAJILA, au domicile duquel le document pré-mentionné a été découvert, se trouve actuellement en résidence surveillée. Les douze autres, à savoir : KYUNGU WA KUMWANZA, TSHISEKEDI WA MULUMBA, KAPITA SHABANI, KASALA KALAMBA KABWADI, LUMBU MALUBA NDIBA, LUSANGA NGIELE, MAKANDA MPINGA SHAMBUYI, KANANA TSHIONGO WA MINANGA, NGOY MUKENDI, BIRINGAMINE MUGARUKA, DIA OKEN NDEL, MBOMBO LONA feront également l’objet des poursuites judiciaires.
Et le plus grave encore, comme pour défier l’Autorité, quatre de ces quatre signataires, les Commissaires du Peuple TSHISEKEDI, MAKANDA, KAPITA et KANANA sont venus ce matin se constituer prisonniers au Mont Ngaliema que le Président-Fondateur, Président de la République, Chef de l’Etat considère comme sa Résidence de travail et Zone neutre.
Cette attitude provocation ouverte est inadmissible. C’est ainsi que je demande pour les quatre Commissaires précités la levée immédiate de leur immunité parlementaire, avant la clôture de la session en cours, la Cour de Sûreté de l’Etat devant être saisie en procédure d’urgence prévue en matière de flagrant délit.
En outre, tous les Treize signataires seront déférés devant la Commission de discipline du Comité Central du MPR pour répondre des faits ci-dessus.
Cfr. : C.R.A. du Conseil Législatif, Session Ordinaire d’Octobre 1980, Séance du 2 Janvier 1981, pp. 2-3.
- 3. L’arbitraire dans l’Arbitraire
Il faut noter le règne de la l’arbitraire, l’ignorance et la violation de deux dispositions règlementaires et constitutionnelles dans la procédure suivie pour sanctionner les Treize Parlementaires :
1) L’arrestation des Députés eut lieu pendant la session parlementaire. Même en cas de « flagrant délit » et d’ « atteinte à la Sûreté de l’Etat »., il fallait créer une commission spéciale pour délibérer de la demande de la levée de l’immunité (Art. 72 du Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil Législatif). Le recours à la procédure du « message présidentiel » qui, selon les règles en vigueur, ne permettait aucun débat au Parlement, on escamota la création d’une commission spéciale et la tenue d’une discussion sur la recevabilité de la demande de levée de l’immunité parlementaire des Députés.
2) La comparution des Députés devant la Commission de discipline du Comité Central (Commission dirigée par M. Bomboko) était anormale. Bien que le Comité central ait été institué comme un organe hiérarchiquement supérieur de l’arsenal des organes du Parti-Etat MPR pour vider le Parlement de son contenu et de ses prérogatives et rendre inutiles les Parlementaires, selon l’article 70 de la Constitution révisée, la commission de discipline pouvait mettre fin au mandat d’un Député « en cas de manquement grave à la discipline du MPR », mais il avait été explicitement et expressément convenu qu’une loi devait déterminer la nature des manquements graves. Or, cette loi n’avait pas encore été votée par le Parlement. Cfr. : C.R.A. du Conseil Législatif, Séance du 14 Novembre 1980, pp. 44.
Ces irrégularités et cet arbitraire embarrassèrent sérieusement les Députés. Mais sommés sur l’heure comme de petits enfants de voter sans discussion, intimidés et menacés par le tyran, ses collaborateurs, la Gestapo et tout l’Appareil autoritaire et répressif du Parti-Etat MPR, ils manquèrent le courage qui avait caractérisé leurs pairs signataires de la Lettre Ouverte, ils Députés votèrent la levée de l’immunité de leurs Collègues Parlementaires : Les Treize Parlementaires.
Ce fait est courant tout au long de l’histoire politique congolaise et constitue l’une des faibles graves de l’Elite Congolaise. Les adversaires et les ennemis internes et externes du Congo le savent et utilisent cette faiblesse à fond, en plus des divisions tribale et ethniques ainsi que de la perversion, de la médiocrité consécutive à la destruction, régression et atrophie du thymos pour nous maintenir nous tous dans l’esclavage, la tyrannie, la famine, la misère et le sous-développement permanent.
Trente-deux Députés sur les deux cents présents exprimèrent leur opposition à la procédure soit en votant contre la levée de l’immunité parlementaire de leurs Collègues, soit en exprimant publiquement par l’abstention leur désapprobation.
Toutefois, c’était l’une des rares fois qu’un acte du tyran avait provoqué de telles réserves, réticences et désaveux.
Entre les 9 et 13 Janvier 1981, les Parlementaires inculpés comparurent devant la Commission permanente de discipline du Parti. Le Procureur de la République ne fut qu’« Invité » à participer aux séances, de même que deux de ses avocats généraux.
- 4. Assumer pleinement la teneur de la Lettre Ouverte
Malgré les sévices qui leur étaient déjà infligés sur le lieu de détention et les menaces de pires atrocités ultérieures, sept de Treize Parlementaires déclarèrent fermement, héroïquement et courageusement assumer pleinement la teneur de la Lettre Ouverte : TSHISEKEDI, NGALULA, MAKANDA, KYUNGU, KAPITA, KANANA et LUMBU.
Les six autres affirmèrent notamment qu’ils n’avaient eu le temps de lire toute la Lettre mais qu’ils en assumaient l’esprit…
L’ex-parlementaire et membre du Comité Central, KIBASSA MALIBA, accusé d’avoir participé à une réunion avec les Parlementaires inculpés, expliqua qu’« un changement profond devait intervenir dans le pays pour éviter qu’on arrive à une catastrophe et à une tragédie ».
- 5. Extraits du Procès -Verbal de l’audience du 9 Janvier 1981 de de la Commission de discipline du M.P.R.
NGALULA PANDAJILA précise que le Document résume les opinions qu’il a toujours défendues au Conseil Législatif avec la différence qu’il a eu le temps de les rassembler. Les actes d’un parlementaire ne se pas qu’au Parlement. Il n’y a aucun texte qui restreint l’activité parlementaire.
Si je me contentais de ce qui se dit au Parlement, je serais irresponsable ou complice des malheurs qui peuvent s’abattre sur le pays. J’ai voulu contribuer à l’amélioration de la situation. Quant au fond, j’ai agi en militant sincère.
C’est même un devoir constitutionnel de tous les instants. Je me suis adressé au Responsable du Pays. C’est un homme comme tous les autres, il peut se tromper également. Je prétendais qu’on s’est écarté et qu’on s’écarte encore de la doctrine du MPR.
Le Manifeste de la N’Sele en soi n’est pas contre la création d’un autre parti, car, après le Manifeste, il y a eu la Constitution de 1967 qui n’imposait pas le monopartisme. J’ai toujours demandé qu’on me démontre le contraire. J’ai voté la Constitution, mais au sein du MPR, on doit pouvoir discuter de certaines choses et on ne doit pas toujours dire « Amen ».
TSHISEKEDI : J’ai agi en militant et non en courtisan. Le Président a tous les pouvoirs, ceux-ci ne sont limités nulle part.. Par conséquent, on ne s’en prend qu’au Responsable n° 1 du Pays.
Comme base de notre démarche, nous invoquons le Manifeste de la N’Sele. Sous ce rapport, nous sommes les militants les plus purs. Il n’y a pas de groupe, il n’a que des citoyens courageux. Mes idées sont mes idées, que je les diffuse ici, à l’Etranger ou ailleurs, j’en assume la responsabilité.
MAKANDA MPINGA : Nous avons utilisé toutes les autres voies pour faire connaître la gravité de la situation. Le discours du 1er Juillet 1977 nous donnait l’espoir, l’espoir d’améliorer la situation parce qu’il n’y a plus d’hiatus entre le peuple et le pouvoir. Quant au respect des principes du MPR, je dis que les idéaux du MPR sont défendus dans ce document, car, au-dessus de la Constitution, il y a le Manifeste de la N’Sele qui en est comme l’épiphanie.
KYUNGU : J’ai signé le document en connaissance de cause parce qu’il se situe dans le cadre de mes activités parlementaires. Quant aux termes utilisés que vous jugez inadéquats, je réponds que j’ai le droit d’atteindre le Président pour lui dire des choses qui lui déplaisent. Le système actuel n’est pas approprié.
KAPITA : La conclusion est que le Président doit revoir sa méthode de travail.
LUMBU : Le Président ne donne plus aux Commissaires du Peuple l’occasion de s’exprimer comme par le passé. Je suis partisan d’un langage dur ; je suis pour une société dans laquelle il n’y a pas que des flatteries.
- 6. Sanction
Les Treize Parlementaires furent déchus de leur mandat parlementaire et dix d’entre eux (TSHISEKEDI, NGALULA, MAKANDA, KANANA, KAPITA…) de surcroît interdits d’exercer leurs droits civiques et politiques et toutes les fonctions politiques pendant cinq ans
Le 12 Janvier 1981, les sanctions susmentionnées furent prononcées. Ces sanctions étaient graduées selon le degré d’implication de chaque inculpé dans la conception et la rédaction du document jugé d’« acte séditieux » et une « offense au Chef de l’Etat Zaïrois ».
Le 15 Janvier 1981, le Comité Central statua sur le cas de KIBASSA MALIBA qui avait approuvé le contenu de la Lettre Ouverte et qui fut lui aussi déchu de ses droits politiques et civiques pour « complicité et connivence avec les signataires du document incriminé ».
Cfr. : Décision du Comité Central du MPR dans l’Affaire NGALULA et Consorts, Journal Officiel de la République du Zaïre, n° 3, 1er Février 1981.
- 7. Action des Etudiants à l’Université de Kinshasa en faveur de la Lettre Ouverte, des Treize Parlementaires et contre le Président Mobutu et contre son régime
Cfr. : Voir prochainement mon Curriculum Vitae, Chapitre de mon engagement politique, notamment ce que nous avons fait à partir de l’Université de Kinshasa pour être le Relais, le Pont, la courroie de transmission et la Passerelle dans les échanges entre les Etudiants et les Parlementaires dès la période des Interpellations (1978-1979) jusqu’à la sortie de la Lettre Ouverte, la diffusion de ladite Lettre, la Campagne nationale et internationale en faveur des Treize Parlementaires, les deux grèves et manifestations à l’Université suivies de deux fermetures de l’Université par Mobutu en 1981 et 1982… Les autres acteurs et les témoins de cette Action collective à l’Université sont encore vivants aujourd’hui et peuvent témoigner.
Fait le 09 Mars 2014
Dr François Tshipamba Mpuila
Bureau d’Etudes, Expertise et Stratégies
BEES 252
E-mail : tshipamba.mpuila@yahoo.fr
 -Liste des 22 Premiers Ministres depuis 1960
-Liste des 22 Premiers Ministres depuis 1960